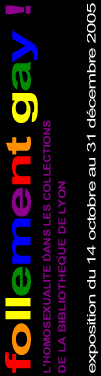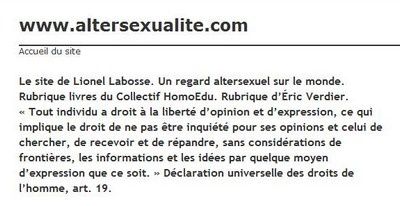Un Protestant, Georges Portal (1936)
 Journal très libre d'un jeune homme, né en 1887, qui découvre son homosexualité à travers les attirances pour ses camarades. Si le narrateur, qui porte le même nom que l'auteur, les refoule dans un premier temps, il se trouve rassuré de les trouver présentes dans la littérature (1). Au cours de la première guerre mondiale, alors qu'il est soldat, de fausses accusations de détournement de mineur le conduisent en prison où il rencontre l'amour.
Journal très libre d'un jeune homme, né en 1887, qui découvre son homosexualité à travers les attirances pour ses camarades. Si le narrateur, qui porte le même nom que l'auteur, les refoule dans un premier temps, il se trouve rassuré de les trouver présentes dans la littérature (1). Au cours de la première guerre mondiale, alors qu'il est soldat, de fausses accusations de détournement de mineur le conduisent en prison où il rencontre l'amour.
Enfant, Georges Portal, le narrateur, a fort peu d'amis. Sa mère les lui choisit avec soin. Il y a Louis, un enfant sage, distingué, et un peu froid, qui a des manières de jeune lord anglais. Pour les parents de Georges, il est le type idéal de l'enfant bien élevé qui ne prend jamais part à des jeux violents. André est tout l'opposé de Louis : sa large figure, sa voix sonore, sa turbulence, son humeur, trahissent le Méridional pur sang. Les trois enfants se réunissent tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre.
A cette époque, parmi tous les jeux, celui qui emporte l'adhésion de Georges est le théâtre de marionnettes. Lorsque qu'il donne une représentation, il aime que celle-ci produise une impression de terreur. Comme son public le sait, il fait en sorte d'avoir peur d'avance.
A 12 ans, ses parents l'envoient faire ses études à Zürich, en internat où il découvre que l'univers ne se borne pas au foyer paternel, aux coutumes d'un pays. Ses camarades de classe se moquent bien sûr de lui, en l'appelant Franzose. C'est ainsi que son patriotisme s'éveille, ardent, stupide même, comme il le reconnaîtra plus tard. Il se met à taquiner Walther, l'Allemand, qui lui flanque quelques roulées. Jamais sa pureté ne souffre, pendant cette période, de la promiscuité de ses camarades, car leurs âmes sont alors aussi candides que la sienne.
Les dessins du magazine « La Vie Illustrée » éveillent peu à peu sa sensualité : notamment un, représentant Une chaîne de forçats en partance pour Cayenne. Il le regarde chez lui en cachette – alors qu'il n'a aucune arrière-pensée précise – comme si sa sensualité, dès son éveil, avait déjà honte d'elle-même :
« Il y avait sur cette photographie des zouaves et des gendarmes, mais ce n'étaient point les effigies de ces défenseurs de l'ordre qui m'avaient plu. Ceux que je regardais, c'étaient les forçats, et je ressentais pour eux une inexplicable sympathie. […] Un de ces forçats était plus particulièrement mon ami : celui qui descendait du quai et prenait pied sur le canot. Les autres étaient laids pour la plupart ; je ne les regardais point. Lui était beau. Son fin profil penché, sa main droite tendue, qui tirait sur la chaîne mince, sa main gauche posée sur sa hanche pour maintenir le sac volumineux, sa stature svelte et juvénile, tout en lui me plaisait. Je l'ai contemplé souvent en cachette, ce jeune condamné inconnu. [...] L'événement que fut dans mon enfance l'achat de ce numéro de la Vie Illustrée marqua une date dans mes candides amusements nocturnes. […] Je me complus aussi à devenir le compagnon de chaîne du beau forçat. Rivé à lui, vêtu comme lui, je m'embarquais pour Cayenne, cité inconnue, au ciel lourd de mystère... Souvent, je m'endormis, croyant poser ma tête sur l'épaule de cet homme auquel j'avais lié ma destinée ; de ce jeune criminel que je n'ai jamais connu. » (pp. 38-39)
A 16 ans, la candeur de Georges est encore totale. Si bien gardé de toute révélation extérieure concernant les choses sexuelles, il en ignore tout. Il ne sait pas même que la femme n'est pas conformée ainsi que l'homme. Une nuit, après avoir observé dans le détail sur une image d'Epinal, un barbier, il imagine que ce dernier vient le ligoter et le saigner tout vif :
« Le coutelas (un porte-plume en os blanc) allait être planté dans mon ventre... (Pourquoi me saignait-on par le ventre ? Je l'ignore. Mais c'était le rite consacré.) Je retenais mon souffle. Mon abdomen n'ayant, hélas, aucune ouverture permettant l'introduction de l'arme mortelle (en l'occurrence le porte-plume), je la plantais un peu plus bas que mon nombril, dans le seul orifice qui s'offrît à ma fantaisie. Je sentais la lame aiguë pénétrer dans ma chair. Offert à ses coups, prisonnier de la chaîne fragile, je me débattais, luttant de toutes nies forces contre l'agonie exquise que je recherchais. […] je ressentis brusquement une ivresse insolite... Emporté par un vertige auquel je ne m'attendais pas, je perdis soudain le contrôle de moi-même. Mon corps fut la proie d'un spasme tel que je n'en ai jamais connu depuis. […] Pour la première fois, du sang s'échappait de la blessure, du vrai sang... Je le sentais jaillir malgré l'opposition du porte-plume et couler tout chaud sur ma peau nue... M'étais-je réellement blessé ? Affolé, voulant enrayer l'hémorragie, je repoussai mes couvertures, allumai l'électricité et regardai l'intérieur de ma couche, m'attendant à le trouver inondé de sang. Il n'en était rien. […] Je fus envahi par une obscure terreur. D'où provenait ce sang incolore ? Qu'était-il ? N'allait-il pas manquer à mon organisme ? » (pp. 44-45)
Georges prend alors conscience de son attirance pour les garçons. Il commence par les regarder, comme ce serrurier qu'il voit passer dans la rue :
« Seul, le bel apprenti accaparait mes pensées. Je m'imaginais qu'il m'adressait la parole, qu'il m'entraînait derrière le viaduc, dans les terrains vagues aux mystérieux et sombres recoins. […] Je le regardais seulement. Il était beau. Sa veste bleue de toile rude cambrait ses reins en hiver, battait ses flancs en été. Je me rappelle qu'un matin de juin, il portait une chemise rose vif, déboutonnée, flottant autour de sa poitrine en sueur, que j'avais envie d'embrasser. Son pantalon de velours marron tranchait avec sa veste claire ; un pantalon que j'ai admiré souvent, et dont j'ai longtemps rêvé avec le désir obsédant de poser mes lèvres sur ce velours, à la place pâlie, usée, où brillait parfois un bouton. » (p. 48)
Georges se garde bien à ce moment d'exprimer ses ressentis à ses camarades. Il invente, devant eux, une danseuse étoile qu'il rencontre régulièrement. En son for intérieur, il est miné par les interrogations :
« […] pourquoi n'en parlait-on jamais ? Etait-ce défendu ? Où trouver ceux qui me ressemblaient ? Parfois, je me demandais avec effroi si je n'étais pas seul de mon espèce, si je n'étais pas un monstre, et ce que j'allais devenir. J'avais appris en quoi consistait l'amour, et pourtant l'énigme subsistait. Il devait y avoir autre chose. » (pp. 56-57)
Le roman de Jean Bosc (1), que Georges a vu en librairie à cause de son titre – Le vice marin –, lui fait comprendre qu'il n'est pas un monstre. Ce qu'il a jusqu'à ce jour imaginé, d'autres avant lui l'ont déjà, réalisé. Sa solitude est finie, un compagnon, un frère, l'habitera.
Le sport devient alors son principal plaisir : football, course à pied, rugby. Georges aime certes ces jeux pour eux-mêmes, mais aussi parce qu'ils lui procurent des satisfactions d'une autre nature, que personne ne soupçonne. L'odeur chaude de tous ces jeunes athlètes et la vue de leurs corps souples, dont les maillots décèlent les recoins les plus intimes, le jettent dans des émois profonds. Mais son éducation, et surtout sa timidité, l'empêche de provoquer une occasion qu'il rêve. Au point qu'il n'envisage pas d'autre avenir que le mariage.
Lors de son service militaire dans la cavalerie, malgré tous ses efforts sur le terrain des manœuvres, il se révèle un piètre soldat sur sa monture. Avoir l'air d'un cavalier lui suffit. Il ne cache rien à sa mère sur les déboires de ses classes à cheval :
« Comme j'appartenais tout entier à ma mère, je ne lui cachais jamais rien. En dehors de mes secrets sexuels, qu'une invincible pudeur m'empêchait de lui révéler, j'étais resté, à vingt et un ans, son fils tout nu. » (p. 75)
A la faveur d'un accident de cheval, sans réelle gravité, il est nommé secrétaire du major, au bureau de la mobilisation. Il rencontre peu après un soldat, Robert, pour lequel il éprouve des sentiments très particuliers :
« Beau garçon sans fadeur, il me plut d'abord parce qu'il était de nous tous celui qui semblait avoir le plus vécu. Je me pris peu à peu à l'aimer violemment. Je m'en rendis compte un jour que nous avions «chahuté» ensemble. Il m'avait renversé, par terre et me tenait sous lui. Soudain, ma défaite m'apparut comme une possible victoire. […] Je ne lui laissai rien deviner de mes sentiments, mais un jour, alors qu'il était en permission, je lui écrivis. Ma lettre, tendre et timide, ne réclamait que la faveur d'une amitié intime. Robert était tellement informé de la vie qu'il pressentit mes mobiles. Je ne le sus que plus tard. Il me l'avoua quand la pureté de mon attitude l'eut rassuré. Ma réserve sexuelle dissipa ses soupçons, au moment même où ma passion pour lui était à son comble. Il n'y avait pas de garçon plus normal que Robert, ni d'ennemi plus déclaré de mon vice secret. Je conquis son amitié parce que je sus me passer d'un amour auquel il ne pouvait répondre. J'eusse souffert bien davantage de son refus que de mon silence. » (pp. 80-81)
Georges propose un jour de monter, avec Robert, chez une prostituée, pour enfin le voir nu :
« C'était moi qui avais suggéré cette escapade, dont il ne soupçonnait pas le vrai motif. Pour la première fois, pour la seule fois, je le vis nu, mais il était bien trop attiré par la prostituée pour remarquer que je n'avais d'yeux que pour lui. Son corps était harmonieux, souple et fort, comme je l'avais imaginé. Habile aussi. Devant moi, avec maîtrise, il prit la femme. Je me repus du rythme puissant de ses reins, que je trouvai magnifique ; du balancement viril de son large corps couvrant l'autre. Fasciné par ce spectacle, il me semblait que j'assistais à un rite divin. Ce fut à cette minute que je cessai réellement d'être vierge. Lorsque leur étreinte se dénoua, je succédai à Robert, très vite, car c'était lui que je cherchais, et il fallait que la place fût chaude. En pénétrant à mon tour la chair qu'il avait pénétrée, je me donnai à lui. Je me donnai à lui sous ses yeux, et il ne le sut pas. » (p. 83)
Il est indifférent à Georges de ne point aimer les femmes, mais comme il lui est aussi impossible de concevoir la vie sans le mariage, une réelle angoisse l'étreint lorsqu'il songe à son avenir. La paternité lui paraît la plus grande joie humaine, en même temps que le premier des devoirs. Une idée le hante : se marier, avoir un fils, et devenir veuf aussitôt après.
Il tente de se confier à un oncle médecin qu'il admire :
« D'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même, je risquai l'impudique aveu. Je lui dis mon inquiétude de ce que les femmes ne me faisaient point envie... l'attirance qu'exerçaient sur moi les jeunes gens... Il m'avait fallu beaucoup de courage. J'attendais un conseil, un secours... Rien ne vint. Mon brave homme d'oncle ne saisit ni la gravité de ma confidence, ni ce que mon appel avait de déchirant. Il me répondit :
— Mais c'est tout naturel, mon garçon. A ton âge, on éprouve toujours cela, c'est de la timidité, ça passera. » (p. 96)
Avec la mort de sa mère, en 1912, Georges ressent simultanément le désir de mourir et la crainte de la mort. Il devient intransigeant avec son père et lui en veut constamment. Son père meurt l'année suivante. La foi le quitte et il se réfugie dans un patriotisme acharné, avide d'héroïsme et de sacrifice. Il voit dans la mort au champ d'honneur la possibilité d'un suicide camouflé, et sa seule délivrance.
Georges vit replié sur lui-même comme un prisonnier dans une cellule. L'amitié, il ne la connaît pas, son secret s'interposant entre les autres et lui. Il est pourtant attiré par les hommes qui portent les rudes stigmates du travail manuel. Au promenoir d'un cinéma, il fait la rencontre avec un chauffeur-mécanicien, Auguste :
« Auguste savait ce qu'il voulait et il ne perdit pas de temps pour me le faire comprendre. Comme ma hâte égalait la sienne, il ne me vint même pas à l'idée de me faire prier. J'avais tellement souhaité cette minute, que je connaissais d'avance mon rôle, sans l'avoir jamais rempli. Il me cloua sur le lit, et s'empara de moi d'un rythme pesant. Jamais je n'avais ressenti une aussi prodigieuse joie physique. Une vie nouvelle me pénétrait en même temps que lui, et s'installait ainsi que cet homme, dans ma chair. Je connaissais enfin l'acte, et l'acte tenait tout ce que j'en attendais. Je ne m'étais pas trompé sur moi-même. Je n'avais pas de honte. Mon amant desserra son étreinte, et me quitta pour fumer à mon côté une cigarette. Je le regardais en silence, tout fier d'avoir servi à son plaisir. J'avais oublié le mien, ne pensant qu'à celui que j'avais donné. Il m'en demanda encore, et je lui en offris tant qu'il en voulut, pendant toute la nuit. » (p. 144)
A cette époque, Georges est inscrit dans un cours de théâtre et interprète quelques petits rôles. Il découvre le bonheur avec Auguste jusqu'au jour où ce dernier, lassé, l'abandonne. Georges le remplace rapidement mais ne trouve aucune attache sérieuse. Un jour, un amant Suisse de passage lui vole sa bague. Georges, qui a appris à s'accepter, n'hésite pas à porter plainte, contrairement à ce que le filou a prévu. C'est ainsi que la police va garder trace de ses fréquentations et de ses mœurs.
Quand la guerre éclate, Georges est appelé. Il exige de rejoindre son régiment de cavalerie. Il est chargé de faire la liaison entre les différents bataillons. A un moment crucial, il voit toute sa vie défiler devant lui, tous les siens, toutes ses joies, tous ses deuils. Lui revient alors une sentence qu'il avait lue sur la tombe de son grand-oncle : « Aime, et reste d'accord ! »
Il apprend bientôt la mort de son frère, lui aussi soldat. Le même jour, son supérieur lui apprend qu'il va être cité à l'ordre de la brigade pour sa belle conduite depuis le début de la campagne et en particulier pour la journée du 15 septembre. Il comprend alors que rien ne peut payer une vie humaine. Le 12 octobre 1914, il est blessé à la jambe. Sa première crainte est de ne plus pouvoir – la paix revenue – tenir son métier d'acteur. On l'évacue et est hospitalisé dans une petite préfecture du Centre. Ensuite, il passe deux mois de convalescence à Paris : un Paris à l'atmosphère insolite. La grande cité, installée dans la guerre, a repris ses habitudes ; les lieux de plaisir, les théâtres, ont rouvert leurs portes. Une sensualité frénétique y règne, dont la jeunesse mâle rassemblée sous les drapeaux constitue le pôle attractif : époque de paroxysme sensuel qui favorise toutes les débauches. L'armée laisse dans son sillage une chaude odeur de sexe, à laquelle les uniformes, avec leurs aciers et leurs cuirs, ajoutent un mystérieux et aphrodisiaque piment. Georges se livre pendant son congé à la plus fructueuse des chasses à l'homme :
« La guerre se prolonge, pensais-je ; qui sait si je serai vivant dans six mois ?... Il faut que je jouisse de tout, sans perdre une minute ! » (p. 213)
Commencé par des orgies, sa convalescence se termine sur une idylle. C'est un jeune Parisien, Gilbert, soldat dans la marine, qui lui apporte une âme loyale, simple et une fraîcheur : leur liaison prend dès le premier jour un caractère conjugal, un goût de vertu. Lorsque Gilbert le quitte pour regagner son port d'attache, ils font mille projets d'avenir.
« Un marin, pour moi, n'est pas un homme comme les autres. De même que les navires ont leur odeur particulière, âcre et nostalgique, qui grise ou qui écœure le passager dès qu'il s'embarque, de même la chair d'un matelot, gainée de son maillot tiède, exhale une senteur à laquelle nulle autre ne saurait être comparée. […] A la fin de ma permission, lorsqu'il me fallut quitter Gilbert dont le congé expirait aussi, je bâtissais avec lui cent châteaux en Espagne. Notre liaison avait des racines trop profondes, pour ne pas comporter le goût et le besoin de la durée. « Après la guerre, nous vivrons ensemble... » disions-nous. Après la guerre ! Échéance fixée à chaque printemps, reculée toujours, et qui semblait de plus en plus lointaine. Nous nous séparâmes sur le quai de la gare. » (pp. 249-250)
 Une fois rétabli, Georges retrouve son régiment mais sa jambe mal consolidée le rend inapte au service actif. On lui donne un emploi administratif. Loin de se calmer, sa frénésie sexuelle se développe de jour en jour. Des amis de Paris lui communiquent l'adresse d'un homme complaisant qui reçoit chez lui des jeunes gens judicieusement choisis. Mais pour Georges, trop de facilité engendre la monotonie et il ne peut se contenter d'un pis aller qui le prive du plaisir de la chasse. La maison close n'est pas la rue.
Une fois rétabli, Georges retrouve son régiment mais sa jambe mal consolidée le rend inapte au service actif. On lui donne un emploi administratif. Loin de se calmer, sa frénésie sexuelle se développe de jour en jour. Des amis de Paris lui communiquent l'adresse d'un homme complaisant qui reçoit chez lui des jeunes gens judicieusement choisis. Mais pour Georges, trop de facilité engendre la monotonie et il ne peut se contenter d'un pis aller qui le prive du plaisir de la chasse. La maison close n'est pas la rue.
Fin 1915, parce qu'il a appris la langue allemande, Georges obtient un poste de surveillance des prisonniers allemands. Un jour, un adolescent, Bernard, entrevu un soir à la gare, se présente à lui. Le jeune garçon, qui ne peut ignorer les mœurs de Georges, s'est enfui de chez lui et demande l'hospitalité :
« Ainsi, au moment où ma vie avait pris un cours paisible, où mes sens, après tant d'heures fiévreuses, s'étaient endormis, cet adolescent venait à moi. Il m'apportait comme une offrande, avec une volonté précoce de petit homme en révolte, son pur visage où ses yeux noirs mettaient une flamme ingénue, sa grâce naturelle, sa jeune force, sa bouche inexperte d'enfant... […] En une seconde je sus ce que je voulais, et que je voulais tout. Oui, tout : cette chair adorable, son émoi, sa chaleur ; et du même coup tous les dangers que me ferait courir cette conquête inestimable. Je n'aurais qu'une nuit peut-être, mais rien au monde ne m'eût empêché, pour prendre cette nuit, de braver tous les risques. » (p. 244)
Le soir même, il doit se rendre à une convocation dans une ville voisine : il décide de s'y rendre avec le jeune garçon de quinze ans et demi. Il révèle à son capitaine une partie de la vérité à savoir la fugue de cet enfant après les mauvais traitements dont il a eu à se plaindre et la décision qu'il a prise de le raisonner pour qu'il retourne chez lui.
La nuit que Georges passe auprès de Bernard, lui laisse le souvenir d'une fraîche oasis au milieu de ses innombrables nuits. Pourtant il n'hésite pas à chapitrer l'adolescent et lui fait comprendre que le seul parti raisonnable est de retourner auprès des siens : pour cela, il lui donne de l'argent pour son voyage et se sépare de lui. Par malheur, Bernard ne rentre pas chez lui, et une plainte est déposée contre Georges.
Face à cette situation, Georges fait détruire tous les papiers compromettants (lettres et photographies de nus) conservés dans sa garçonnière de Paris.
Le drame éclate pourtant le 10 janvier 1916. Un article du Petit Garandais, annonce en caractères gras une « Grave affaire de mœurs ». Georges est accusé d'outrages publics à la pudeur et d'excitation de mineurs à la débauche sans aucune référence à Bernard et à sa fugue. Malgré ses bons services, le tribunal militaire le condamne à quatre mois de prison sans sursis. Il est aussi cassé de son grade.
En prison, il fait la connaissance de Charlot, lui aussi prisonnier. Georges ne lui indique pas le motif réel de sa condamnation. Charlot, un marin, a été lui-même condamné pour une blague. Il fait office de cuistot à la prison et bénéficie de ce fait de certaines faveurs.
« — […] tu me plais. Je crois qu'on fera bon ménage ensemble.
Je ne répondis pas, mais je pensais : marin ! C'est un marin !... Et ma sensualité réveillée attendit l'aubaine inattendue.
Déjà il avait passé son bras autour de mon cou, et m'enlaçait familièrement, tandis qu'au-dessus de nos têtes la fenêtre grillée, envahie par les ténèbres, semblait s'être fermée jusqu'au lendemain.
— C'est pas tout ça, me dit-il en prenant un air dégagé. Il fait encore froid la nuit, tu sais, et on n'a qu'une couverture chacun. En faisant un seul lit, on aurait plus chaud. Laisse-moi faire je vais arranger ça.
[…] Pendant que j'achevai de me dévêtir, et que je m'étendis à son côté, il ne me quitta pas des yeux.
— Tu as dû en faire des béguins, reprit-il soudain ; tu es beau gosse !
[…] Et comme je protestais encore, pour la forme :
— Ben quoi ! Ça ne t'aurait pas plu, de porter le col bleu ? Bien sûr, ce n'est pas drôle tous les jours, et c'est le dernier des métiers, mais le costume est joli, quand on est girond !
Dans un éclair, cet homme venait de réveiller en moi tout un monde de sensations inassouvies... Je revis le livre avec l'image du jeune mousse que je ne serais jamais... la chaîne de forçats de la Vie Illustrée. La cellule s'illumina soudain de tous mes rêves d'adolescent.
Mon compagnon avait les cheveux ras, comme un bagnard ; il me regardait toujours, et souriait. Je savais bien pourquoi il me regardait ainsi, mais je lui demandai avec une malice provocante :
— Pourquoi diable tenais-tu tant que ça à m'avoir dans ta cellule ?
Dans ses yeux gris passa une lueur de sensualité moqueuse.
Brusquement, il souffla la bougie, et me dit à voix basse, à l'oreille, en me serrant contre lui :
— T'as compris, mon petit gars...
Puis, d'un coup de reins, il se rapprocha. » (pp. 294-297)
A sa sortie de prison, avant de s'embarquer pour rejoindre un régiment en Afrique du Nord, Georges revoit son oncle médecin, toujours plein d'attentions pour son neveu. A la question de savoir, s'il est heureux, Georges lui répond :
« — Non seulement, lui dis-je, je suis pleinement heureux, mais je ne regrette rien, et même, je puis te l'avouer maintenant, je suis fier !
Comme il parut surpris malgré tout de ce mot, j'ajoutai :
— Oui, fier ! Comment t'expliquer mon sentiment ? Je mentirais si je ne t'avouais pas cette fierté, absurde peut-être, mais réelle. Il me semble que j'échappe à une règle universelle, que je suis un privilégié, tout comme si je pouvais vivre sans respirer, marcher sur la mer, ou vaincre à ma fantaisie les lois de la pesanteur. C'est stupide, sans doute, mais ce que j'ai tout d'abord combattu en moi, puis ensuite accepté, je le revendique aujourd'hui.
— Curieux orgueil, me répondit mon oncle. Mais j'aime mieux te voir ainsi. […]
— Ce qui m'inquiète pour toi, mon petit, me dit-il après un court silence, ce sont toutes ces aventures crapuleuses, ces rencontres de hasard, ces courses incessantes de plaisirs en plaisirs. Ne pourrais-tu te choisir un ami, et le garder longtemps ? […]
Quelques jours plus tard, seul en pleine mer, je songeais à cette dernière conversation, et à tout ce que je n'avais pas dit ; car une autre fierté m'habitait : celle de ne pas subir le joug de la femme. Le spectacle de mon oncle, ridiculisé et annihilé par la sienne, m'avait trop exaspéré pour que je n'y eusse pas réfléchi. Moi, je ne me soumettais qu'à mon semblable, à mon égal : à l'homme. Et ma chair seule lui était soumise. Oui, j'en éprouvais de l'orgueil !
Mais une parole m'avait frappé plus que toutes les autres : « Ne pourrais-tu te choisir un ami ?... » Choisir. Je sentais bien que cela n'était pas possible, et qu'on ne choisit point. Le hasard seul dispense à l'homme les joies qu'il mérite. Si je le méritais, cet ami se trouverait sur ma route à l'heure marquée pour notre rencontre, dût-il venir de l'autre bout du monde. J'attendrais. » (pp. 329-330)
■ Un Protestant, Georges Portal, Editions Denoël & Steele, 330 pages, 1936
& Editions Le Serpent à Plumes, 384 pages, janvier 2019, ISBN : 9791035610654, 20€
(1) cf. Le Vice marin, confessions d'un matelot [Jean Bosc, Paris, Pierre Douville, 1905] dont le narrateur fait référence à plusieurs reprises notamment page 57 ; L'autre vue [titré aussi Voyous de velours, Georges Eekhoud, Mercure de France, 1904] dont le narrateur fait référence à la page 263, sans oublier en épigraphe un passage du Corydon d'André Gide.
Avertissement des éditeurs en page 9 : L'évidente authenticité des confessions que voici, leur intérêt documentaire, le talent de l'auteur nous ont paru compenser suffisamment l'audace de certaines peintures et la crudité de certains aveux pour nous épargner le soupçon de céder à des motifs d'un aloi douteux en les publiant. Toutefois, il ne nous semble pas inutile d'indiquer que le présent ouvrage est le premier volet d'un diptyque (1). Un deuxième volume doit suivre qui montrera avec une égale sincérité et un égal courage, – après les abandons et les défis qui terminent Un Protestant, – l'homme de plaisir aux prises avec une passion exclusive et avec les problèmes les plus graves et les plus purs que pose l'amour. Cette seconde partie emprunte l'essentiel de sa valeur psychologique à son contraste avec la première qu'elle complète et, s'il en était besoin, achèverait de justifier.
Les Editeurs
(1) : Je n’ai pas trouvé trace de ce second volet !
Lire la chronique de "Bibliothèque Gay" sur son site

/image%2F1477403%2F20150214%2Fob_a07756_banniere-blog-nouvelle-version-2015.jpg)


/idata%2F0051799%2Flogo%2Flivre2.jpg)