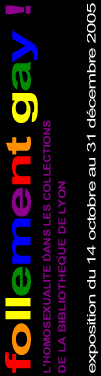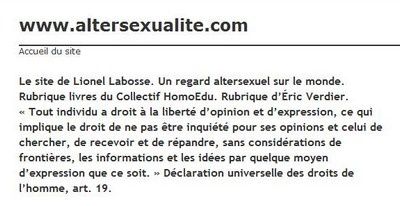Le secret de Vauvenargues par Pierre Fontanié
 Il n'y a personne qui sache passer aussi commodément du particulier au général, réunir le plus grand nombre d'idées en économisant les phrases et jusqu'aux mots, et transformer le lieu commun en terrain privilégié de la communication, qu'un auteur de maximes et de réflexions ne le fait en livrant ses productions à un public indigne de le connaître. Je parle du publie de notre siècle, car celui de son temps le pouvait, et si l'ouvrage immortel de Vauvenargues nous est présenté dans une collection de poche, rassurons-nous ! Sa méconnaissance viendra moins de la nécessité de la fortune que de l'excellence du cœur et de l'esprit. Car nous le voulons ignorer de la multitude.
Il n'y a personne qui sache passer aussi commodément du particulier au général, réunir le plus grand nombre d'idées en économisant les phrases et jusqu'aux mots, et transformer le lieu commun en terrain privilégié de la communication, qu'un auteur de maximes et de réflexions ne le fait en livrant ses productions à un public indigne de le connaître. Je parle du publie de notre siècle, car celui de son temps le pouvait, et si l'ouvrage immortel de Vauvenargues nous est présenté dans une collection de poche, rassurons-nous ! Sa méconnaissance viendra moins de la nécessité de la fortune que de l'excellence du cœur et de l'esprit. Car nous le voulons ignorer de la multitude.
C'est que Vauvenargues nous offre des sentences universelles qui paraissent convenir à l'ensemble des hommes, alors qu'elles sont le fruit de l'expérience d'un seul. Il y a bien de la pudeur à se raconter de la sorte et c'est une façon de ne pas rendre le moi « haïssable » que de le déguiser. Peut-être les choses les plus essentielles nous échappent alors, mais au prix d'un peu de raison n'est-il pas possible de redécouvrir le vrai Vauvenargues et de percer son secret car il nous semble qu'il y en ait un et que celui-ci nous concerne, nous, les lecteurs d'Arcadie
Lui-même a pris soin de nous prévenir : « Je hais le jeu et les femmes, du moins, celles que je connais ; cela fait que je ne vais guère dans le monde, et que je m'y ennuie extrêmement ; il y a des esprits malins qui tirent de ce dégoût de quoi me faire plusieurs crimes » (Lettre à Mirabeau, 30 mai 1739). D'où provenait cette haine, sinon de son complexe d'infériorité diront certains ? et cela n'est pas douteux, mais en partie seulement. Dans une seconde lettre à Mirabeau, du 22 mars 1740, il n'y a plus la restriction aux femmes de sa connaissance et une explication est avancée : « Je hais le jeu comme la fièvre, et le commerce des femmes comme je n'ose pas dire ; celles qui pourraient me toucher ne voudraient seulement pas jeter un regard sur moi. »
Non, Vauvenargues n'a pas eu à se louer de la fortune, qui se plaît à nous affliger à proportion de nos mérites. Souffreteux, laid, songeur, gauche, affligé d'une mauvaise santé, incapable de bien servir les femmes, comme il a dû souffrir de la comparaison avec son père, qui le méprisait. Joseph de Clapiers, seigneur de Vauvenargues et de Claos, premier consul d'Aix, s'était distingué au moment de la grande peste de 1720 par l'énergie et la qualité de son action. Il avait mérité ainsi de voir le roi ériger en marquisat les terres de sa seigneurie. Son autoritarisme, nécessaire à l'exercice d'une haute magistrature municipale, vite sombré dans le despotisme privé et Luc de Clapiers a supporté une tutelle aussi gênante avec une irritation dont témoignent plusieurs de ses maximes dirigées contre les vieillards : « On tire peu de services des vieillards parce que la plupart, occupés de vivre et d'amasser, sont désintéressés sur tout le reste » (Maximes de 1747, n°80 - Elle a été complétée par une addition tardive). « Les jeunes gens souffrent moins de leurs fautes que de la prudence ; des vieillards » (Maximes de 1747, n°158). « Je me suis trouvé à l'Opéra, à côté d'un homme qui souriait, toutes les fois que le parterre battait des mains. Il me dit qu'il avait été fou de la musique dans sa jeunesse, mais, qu'à un certain âge, on revenait de beaucoup de choses, parce qu'on en jugeait alors de sang-froid. Un moment après, je m'aperçus qu'il était sourd, et je dis en moi-même : Voilà donc ce que les hommes appellent juger de sang-froid ; les vieil- lards et les sages ont tort ; il faut être jeune et ardent pont juger, surtout des plaisirs » (Maximes posthumes, n°384)
« L'âge peut-il donner droit de gouverner la raison ? » (Maximes retranchées, n°817). Mais, victime de ce maître arrogant et dur, Luc de Clapiers a dû nourrir à son égard des sentiments équivoques, faits d'admiration respectueuse et de crainte, d'envie et de désir de l'égaler, de haine fervente et d'amour filial. Rabaissé, déprécié, nié par lui, il a voulu reconquérir à ses yeux une existence que la lumière du jour ne suffisait pas à lui assurer. Il a cherché la gloire militaire que paraissait lui promettre sa nomination de lieutenant en second, puis de lieutenant au Régiment d'infanterie du roi en 1735. Mais il ne prend part à la campagne de Lombardie que tardivement, après les victoires.
Et c'est le début, en mai 1736, d'une morne vie de garnison, qui le, conduira, au cours des cinq années suivantes, à Dijon, à Besançon, à Arras, à Reims, à Verdun, à Metz... La guerre de Succession d'Autriche éclate enfin. Il participe à la prise de la ville de Prague par les troupes françaises en novembre 1741, et il est promu capitaine le mois d'août suivant. Hélas, après leur fuite de Prague en décembre 1742, les Français se trouvent engagés dans la désastreuse retraite de Bohême et, si Vauvenargues n'a pas eu les jambes gelées, comme on l'a cru si souvent, sa santé (déjà précaire dès son enfance ; ce qui explique ses études fort négligées), loin de connaître une amélioration soudaine, s'aggrave bien plutôt. Nancy devient sa nouvelle garnison en 1743, mais le séjour y est trop bref pour qu'il puisse tirer profit de son hospitalisation et de sa convalescence. Sa carrière militaire est bien finie, même si elle se prolonge jusqu'à la mi-janvier 1744, date à laquelle Vauvenargues est démissionnaire de l'armée. Elle est terminée dans son esprit puisqu'il avait entrepris en avril 1743 des démarches pour entrer aux Affaires étrangères et ce n'est pas l'échec de la bataille de Dettingen, le 23 juin de cette année, au cours de la nouvelle campagne, qui le détournerait de ses projets, quand bien même le ministère ne fournirait à ses demandes que des réponses dilatoires, en attendant – il est vrai – d'accorder à la faveur de Voltaire ce qu'il aurait dû au seul mérite. La gloire diplomatique prendra-t-elle le relais de la gloire militaire ? Non pas ! Il est atteint de la petite vérole dont les séquelles achèvent de défigurer un visage déjà disgracié, de compromettre son état général et de miner sa santé, tandis que sa vue est atteinte. Il se désiste, la rage au cœur. Il ne lui reste plus que la gloire des lettres, mais ce ne sont pas, elles qui lui vaudront la reconnaissance paternelle car il passe outre aux volontés de son père pour venir en mai s'installer à Paris. C'est un échec pour lui et il doit surmonter ses propres répugnances. Quand on a rêvé de la carrière des armes et des succès diplomatiques (la diplomatie n'est que la continuation de la guerre par d'autres moyens), quand on s'appelle le marquis de Vauvenargues, puisque son père avait abandonné le titre à son fils aîné (peut-être vers 1735), quand on a ressenti la morsure de toutes les ambitions, talon d'Achille de la Destinée, qu'il est cruel de se retrouver, la plume en main, dans un cabinet d'un hôtel de l'actuel quartier de l'Odéon et de parler de gloire, lorsqu'on aurait voulu la vivre avec toute l'ardeur cornélienne des héros de théâtre ! Pauvre Vauvenargues que nous avons des raisons de croire atteint de tuberculose et qui ne se résigne pas, allant jusqu'à proposer ses services à la Provence contre les Impériaux, malgré l'aggravation de sa santé, en novembre 1746 ! Mais les souffrances comme les ambitions sont calmées par la mort qui survient le 28 mai 1747, cette mort qui guérit de tout quand les médecins du corps et de l'âme ont échoué et qui tient les promesses du néant, achevant de nous convaincre de l'insignifiance de toute chose !
Ainsi Vauvenargues n'a pas réussi dans sa tentative d'identification au père et c'est tant mieux car il eût été un homme comme les autres et certainement pas un écrivain. Ecrire, c'est approfondir une blessure qu'on vous a faite au cœur et dont on ne finit jamais de mourir, calmer le chagrin et la peine par la mélopée fragile des mots, et multiplier les échos sonores du moi aux dimensions de l'univers. Il n'a pas été capable de jouer le rôle que les femmes attendaient de lui, par tempérament et par goût : « J'avouerai ingénument que cette sorte de besoins m'est moins connue qu'à personne ; mais quand ma complexion serait plus forte que celle des patriarches, il me serait impossible de me soumettre à leur joug » (Lettre à Saint-Vincens, 8 août 1739). On ne sait rien des amours auxquelles Vauvenargues fait allusion quand il dit : « pour moi, je n'ai jamais été amoureux, que je ne crusse l'être pour toute ma vie » (Lettre à Mirabeau, 23 janvier 1739), et c'est avec une apparence de raison que certains commentateurs vont jusqu'à les supposer fictives. Il se défiait de l'amour et redoutait les femmes comme on l'a vu par ses confidences, et comme on peut s'en assurer par de nombreuses maximes : « la constance est la chimère de l'amour » (Maximes retranchées, n°755). « Quels que soient ordinairement les avantages de la jeunesse, un jeune homme n'est pas bienvenu auprès des femmes, jusqu'à ce qu'elles en aient fait un fat » (Maximes retranchées, n°722). « Il est plaisant qu'on ait fait une loi de la pudeur aux femmes ; qui n'estiment dans les hommes que l'effronterie » (Maximes retranchées, n°723). « On ne loue une femme ni un auteur médiocre comme eux-mêmes se louent » (Maximes retranchées, n°724). Est-ce philosophie de la part du disgracié Vauvenargues ? « Ceux qui ne sont plus en état de plaire aux femmes, et qui le savent, s'en corrigent » (Maximes retranchées, n°756). Et comment aurait-il pu plaire aux femmes ? Il lui suffisait de se regarder dans un miroir malgré toutes les illusions de l'imagination et de la vanité : « Si, par hasard, je rencontre et regarde un miroir, je suis presque aussi surpris que si je voyais un cyclope, on un habitant du Tartare ; il me semble que ce n'est pas moi, que je suis le corps d'un chien, comme le roi de Babylone » (Lettre à Mirabeau, 22 mars 1740). Il lui aurait suffi encore de faire le compte de toutes ses infirmités s'il n'y avait pas eu du ridicule à une semblable énumération. Mais il y a une autre réalité qui nous aveugle : s'il ne plaisait pas aux femmes, les femmes ne lui plaisaient pas davantage. Il n'avait donc rien à faire dans le monde : « C'est être bien dupe d'aimer le monde, quand on n'aime ni les femmes ni le jeu » (Maximes posthumes, n°682), car « il n'est pas libre à un homme qui vit dans le monde de n'être pas galant » (Maximes retranchées, n°721) et Vauvenargues souligne par cette maxime la contrainte sociale qui s'exerce à nos dépens. Les femmes ne peuvent même pas lui apporter du réconfort : « ne faudrait-il pas qu'elles comprennent qu'il y ait des hommes désintéressés à leur égard » ? (extrait de la maxime n°720, Maximes retranchées). Ce qui est d'autant plus difficile que la nature, ou du moins la société, ne leur donnent une espèce d'existence que relative, leur parure et leurs soins se concevant en fonction de l'homme et de leur finalité biologique, si bien qu'une preuve d'indifférence devient vite à leurs yeux une sorte de négation pure et simple dont on ne peut espérer d'un individu qu'il s'accommode aisément. Plutôt croire à une invraisemblance manifeste que d'imaginer cette attitude de retrait précédée et provoquée par diverses sortes d'expériences malheureuses dans le domaine de l'hétérosexualité. Le vertueux Luc de Clapiers était à n'en pas douter un homophile, incapable d'attirance sexuelle pour les femmes, fasciné par les jeunes adolescents sans que l'idée de la pratique charnelle lui fût venue en raison des préjugés et du moral étayé par le physique, et déguisant son intérêt, comme cela est courant, sous le voile de la pédagogie. « Les premiers jours du printemps ont moins de grâce que la vertu naissante d'un jeune homme » (Maximes retranchées, n°757). Est-ce bien de vertu qu'il s'agit ? et Vauvenargues, écrivain, ignorait-il l'emploi de la litote qui consiste à dire moins pour faire entendre plus ? Samuel S. de Sacy écrit : « Que pensait-il donc, lui qui détestait la vieillesse et les vieillards, de son propre attachement pour les adolescents ? » En fait, Vauvenargues laisse le doute planer : « Pourquoi un jeune homme nous plaît-il plus qu'un vieillard ? Il n'y a presque point d'homme qui puisse se dire pourquoi il aime ou il estime un autre homme, et pourquoi lui-même s'adore » (Maximes posthumes, n°653). A cette question Samuel S. de Sacy ne craint pas de répondre : « Il s'aimait lui-même d'être pour eux le père qu'il aurait aimé avoir. Ils l'auraient consolé de tant de frustrations ! » Cette image du père qu'il s'est plu à reproduire, nous la retrouvons dans son expérience militaire, à l'armée, où son entourage lui reconnaissait une grande autorité morale et où ses camarades l'appelaient affectueusement « père ». Nous la retrouvons encore dans les rapports exemplaires qu'il eut avec deux adolescents. Victor de Riquetti, futur marquis de Mirabeau et père du grand révolutionnaire, était un de ses meilleurs amis et ils étaient liés autant par la convenance de l'âge que par les affinités provinciales. Nés tous les deux en Provence, ils avaient vu le jour la même année, en 1715, Luc de Clapiers le 5 août, Mirabeau le 5 octobre, à la charnière de ce XVIIIe siècle historique qui débute avec la mort de Louis XIV. Or, Mirabeau a un frère, « le petit chevalier », âgé de treize ans en 1737 et c'est en septembre que sa famille décide de le confier à Vauvenargues pour assurer son apprentissage de « cadet ». Pendant plusieurs années, Vauvenargues, promu éducateur, assume gravement les charges de sa fonction tout en éprouvant pour l'enfant les sentiments très tendres d'un grand aîné, mais son élève le décevra par sa dissipation et par son impatience à supporter la protection de son mentor. En mars 1740, une autre famille provençale lui confie un nouveau cadet, Hippolyte de Seytres, du même âge que le chevalier, mais qui lui donnera de plus grandes satisfactions comme éducateur. Mais ce dont la vie se montre prodigue, la mort le reprend avec des gestes d'avare : Hippolyte de Seytres meurt de maladie à Prague, en avril 1742, ce qui affecte durablement Vauvenargues, la vie se passant à pleurer la perte de ceux qui nous sont chers avant de les affecter par notre propre disparition qui nous laisse insensible. Toutefois, cette expérience lui servira car il n'y en a aucune de plus profitable que la douleur qui « bronze » le cœur, à moins qu'il ne le brise, suivant le mot admirable de Chamfort. Ces adolescents ont éveillé en lui la vocation du pédagogue et, à travers elle, le désir de communiquer sa pensée, de la rendre claire à soi-même et aux autres par le moyen des mots, en les disposant de cent manières différentes comme un compositeur de symphonie, dans l'orchestration des thèmes, par l'arrangement des notes. Ils ont jeté des lumières aveuglantes sur sa propre nature à ses yeux et combien de maximes révèlent le lent cheminement de sa réflexion à cet égard. Écoutons cette voix palpitante, le murmure de la confidence ébauchée, l'aveu sourd et muet au a détour de la phrase : « Tout a sa raison ; tout arrive comme il doit être. Il n'y a donc rien contre le sentiment ou la nature. Je m'entends ; mais je ne me soucie pas qu'on m'entende » : (Maximes posthumes, n°360). Etrange paradoxe de l'écriture où l'auteur se livre en pâture à la malignité publique en feignant de s'adresser à lui seul et où la substance de notre moi cesse de nous appartenir dès lors girelle est contenue dans l'équation des mots, extérieure à` nous ! Etrange paradoxe qui renouvelle en l'inversant le mystère de la rédemption, le créateur faisant porter au monde le poids de ses péchés pour obtenir son rachat à lui seul ! « N'est-ce pas encore la nature qui nous pousse même à sortir de la nature, comme le raisonnement nous écarte quelquefois de la raison, oui comme l'impétuosité d'une rivière rompt ses digues et la fait sortir de son lit ? » (Maximes posthumes, n°358). La biologie met un branle un mécanisme, une suite de gestes et d'actions, qui procurent un plaisir tel que la reproduction devint une conséquence possible et non plus une finalité en elle-même, si bien que les jouissances solitaires ou prises en compagnie de nos semblables, en se conformant aux circonstances ou à la chose dont il s'agit, ne cessent pas de nous paraître légitimes. Et comme « il n'est pas donné à la raison de réparer tous les vices de la nature » (Maximes de 1747, n°24), même si « la raison rougit des penchants dont elle ne peut rendre compte » (Maximes de 1747, n°41), « il ne faut pas croire aisément que ce que la nature a fait aimable soit vicieux » (Maximes de 1747, n°122). Le vice est dans l'esprit des hommes, il n'y en a aucun dans l'esprit de cette mère sage et lui en supposer est bien le seul réel qui puisse exister dans une de ses productions où tout est nécessité par l'environnement et par l'essence. « Il n'y a point de siècle et de peuple qui n'aient établi des vertus et des vices imaginaires » (Maximes de 1747, n°122). « Presque toutes les choses où les hommes ont attaché de la honte sont très innocentes : on rougit de n'être pas riche, de n'être pas noble, d'être bossu ou boiteux et d'une infinité d'autres choses dont je ne veux pas parler » (mais nous savons bien quoi). « Ce mépris par lequel on comble les disgrâces des malheureux est la plus forte preuve de l'extravagance et de la barbarie de nos opinions » (Maximes posthumes, n°660).
« Mes goûts, mon caractère, ma conduite, mes volontés, mes passions, tout était décidé avant moi ; mon cœur, mon esprit, et mon tempérament ont été faits ensemble, sans que j'y aie rien pu, et, dans leur assortiment, on aurait pu voir ma pauvre santé, mes faiblesses, mes erreurs, avant qu'elles fussent formées, si l'on avait eu de bons yeux » (Lettre à Mirabeau, 30 juin 1739). Et Vauvenargues de s'écrier courageusement : « Ce qui n'offense pas la société n'est pas du ressort de sa justice » (Maximes de 1747, n°164).
On voudra bien nous pardonner, je l'espère, d'avoir uni en un seul corps de discours des pensées hétérogènes pour en faire un tout cohérent. Mais le genre des maximes et des réflexions qui semble à première vue impersonnel et froid tient davantage de la confession, à notre avis, où l'auteur s'avoue lui-même. Il suffit de le retrouver en déjouant toutes ses ruses qui sont de camoufler en vérité générale une expérience particulière et d'égarer le lecteur par des contradictions, des redites et des propositions fragmentaires (soit en retranchant, soit en ne publiant pas, soit encore en offrant une partie au lieu de l'ensemble), ce qui nous oblige à une reconstitution somme toute archéologique du cœur et des sentiments. Vauvenargues ne nous aurait pas désavoué, lui, qui, voyant La Rochefoucauld à travers ses maximes, détestait ce caractère. « Si l'illustre auteur des maximes eût été tel qu'il a tâché de peindre tous les hommes, mériterait-il nos hommages et le culte idolâtre de ses prosélytes ? » (Maximes de 1747, n°299). Au surplus nous n'avons pas cru jeter une ombre sur sa mémoire en lui attribuant des sentiments et des goûts qui n'ont pas été suivis d'effets, mais, qui, même dans ce cas, ne lui eussent fait ni honneur ni opprobre mais l'eussent rendu plus humain parce que susceptible d'émotion et de souffrance. Car c'était le secret de Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues, fils de Joseph de Clapiers et de Marguerite Bermond, mort sans avoir accompli sa trente-deuxième année, ni aucune de ses ambitions, ni peut-être aucun de ses désirs les plus chers ! Mort aussi dans la solitude, dans l'ennui, dans la tristesse de ses rêveries, dans l'inassouvissement des sens, car « la solitude tente puissamment la chasteté » (Maximes posthumes, n°445) et sa solitude ne fut-elle pas complète à la façon d'un Vigny, ce grand désabusé de tout et de tous ? Vigny qu'il rejoint dans une poésie qui nous touche, contrairement à Voltaire qui blâmait les images météorologiques de Vauvenargues comme étant poétiques, ce qu'il réprouvait dans l'ouvrage d'un moraliste. C'est que sa prose a la passion de la poésie tout en versant dans le laconisme. C'est qu'il sent, c'est qu'il vit, c'est qu'il aurait voulu aimer ! Voilà pourquoi il est si proche de nous.
Arcadie n°225, Pierre Fontanié, septembre 1972

/image%2F1477403%2F20150214%2Fob_a07756_banniere-blog-nouvelle-version-2015.jpg)


/idata%2F0051799%2Flogo%2FARCADIE-LOGO.jpg)
/image%2F1477403%2F20180209%2Fob_4b3279_andre-baudry-deces-2018.jpg)