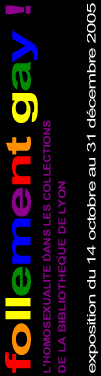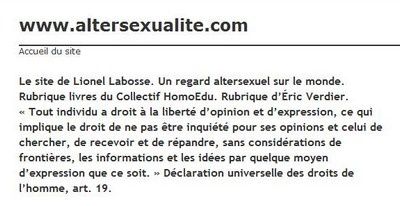Le non-conformisme à la « Belle Epoque » par Marc Daniel
 Le présent texte a été en partie rédigé à partir des matériaux recueillis pour une conférence prononcée au Club littéraire et scientifique des Pays latins, le 6 novembre 1957. Il était terminé bien avant que ne parût L'Exilé de Capri, où Roger Peyrefitte a multiplié, avec l'art qui n'appartient qu'à lui, les aperçus sur la société « arcadienne » précisément de cette « Belle Epoque ». Il m'a cependant semblé que l'Exilé de Capri ne rendait pas inutile cette étude : d'abord parce que Jacques d'Adelswärd-Fersen et son entourage n'occupent dans les pages qui vont suivre qu'une place assez mesurée, ensuite et surtout parce que j'ai eu l'ambition de tracer, à grands traits, une esquisse générale de tous les aspects de la vie homosexuelle aux environs de l'an 1900 en France ; par là, mon propos s'écarte nettement de celui de Roger Peyrefitte, qui traitait en détail d'un cas particulier, alors que j'ai tenté ait contraire de parcourir, sans m'arrêter longuement nulle part, tout le chemin qui séparait, dans le Paris de l'affaire de l'avenue de Friedland et de l'affaire de la rue de la Pépinière, le boulevard Bourdon des Champs-Elysées et le Palais de Justice de la Maison Rose de Montesquiou.
Le présent texte a été en partie rédigé à partir des matériaux recueillis pour une conférence prononcée au Club littéraire et scientifique des Pays latins, le 6 novembre 1957. Il était terminé bien avant que ne parût L'Exilé de Capri, où Roger Peyrefitte a multiplié, avec l'art qui n'appartient qu'à lui, les aperçus sur la société « arcadienne » précisément de cette « Belle Epoque ». Il m'a cependant semblé que l'Exilé de Capri ne rendait pas inutile cette étude : d'abord parce que Jacques d'Adelswärd-Fersen et son entourage n'occupent dans les pages qui vont suivre qu'une place assez mesurée, ensuite et surtout parce que j'ai eu l'ambition de tracer, à grands traits, une esquisse générale de tous les aspects de la vie homosexuelle aux environs de l'an 1900 en France ; par là, mon propos s'écarte nettement de celui de Roger Peyrefitte, qui traitait en détail d'un cas particulier, alors que j'ai tenté ait contraire de parcourir, sans m'arrêter longuement nulle part, tout le chemin qui séparait, dans le Paris de l'affaire de l'avenue de Friedland et de l'affaire de la rue de la Pépinière, le boulevard Bourdon des Champs-Elysées et le Palais de Justice de la Maison Rose de Montesquiou.
I. — BYZANTINISME ET « ÉCRITURE ARTISTE »
Depuis une vingtaine d'années, l'époque 1900 est à la mode. Elle l'est même à tel point qu'on l'appelle, tout rondement et de confiance, la « Belle Epoque », parce que ses sièges étaient capitonnés, ses femmes dodues, son style confortable et ses mœurs apparemment insouciantes.
Peut-être la raison de cette popularité réside-t-elle dans le fait que cet « avant l'autre guerre » fut la jeunesse de nos vieillards d'aujourd'hui, qui règnent sur la presse, le théâtre, le cinéma, la littérature, la radio, tout ce qui crée le goût du public ? Peut-être aussi est-ce parce que ces lignes ondoyantes, cette atmosphère feutrée et capiteuse, ce confort encore si peu mécanisé, exercent sur nos imaginations un attrait un peu comparable à celui des pays exotiques qui, justement, furent alors si fort appréciés ?
Pour nous, l'optique sur la « Belle Epoque » varie, certes, selon l'âge. Ceux qui ont moins de quarante ans la considèrent avec curiosité, un peu d'attendrissement peut-être, mais comme le Second Empire, la Restauration, l'Ancien Régime, c'est-à-dire comme un temps un peu féérique, dont on a lu des anecdotes, avec lequel on ne sent rien de commun, et qui semble si loin, si loin, que ses personnages paraissent avoir vécu sur une autre planète.
Ceux, au contraire, qui ont entre quarante et soixante ans en ont entendu parler par leurs parents, en ont connu encore les protagonistes, en ont respiré, dans leur jeunesse, les derniers parfums, en ont entendu les ultimes mélodies. Pour eux, la « Belle Epoque », c'est ce, que sont, pour ceux de ma génération, les années 1920, celles où nos mères portaient des costumes si bizarres et où elles nous promenaient, bébés, dans de grands landaus que nous rions de voir sur les photographies.
Et puis, il y a ceux qui ont dépassé la soixantaine, et qui l'ont vécue, en leur jeunesse, cette « Belle Epoque ».
Et ceci met brusquement l'historien des mœurs en face de ses responsabilités ; car, tout compte fait, un demi-siècle, c'est peu sub specie aeternitatis ; 1900 n'est pas 1650, et l'on n'aborde pas la vie intime des contemporains de M. Fallières comme celle des courtisans de Louis XIV (1).
Pour le Grand Siècle, on peut espérer être raisonnablement complet, c'est-à-dire faire un tour assez précis de toutes les sources de renseignements sur la question ; l'écueil est même que ces sources sont trop peu nombreuses, et que le tableau de la vie homosexuelle sous le règne du Roi Soleil qu'elles nous offrent est incomplet en beaucoup de ses aspects, faute de témoignages authentiques. Pour 1900, au contraire, la documentation est innombrable. Journaux, revues satiriques, mémoires, œuvres littéraires, scandales judiciaires, théâtre, poésie, et même les souvenirs directs de certains de nos contemporains, tout cela permettrait, à celui qui pourrait tout dépouiller, de dresser non pas seulement une étude d'ensemble mais une multitude d'études de détail, si foisonnante que nous ne pouvons ici que tenter d'en définir les grandes lignes.
Ӂ
Le cinéma, les illustrés et les vitrines d'antiquaires ont, depuis la fin de la dernière guerre, familiarisé les moins curieux de nos contemporains avec le cadre de la vie de la « Belle Epoque », avec ce « Modern Style » aux courbes ondoyantes, dont les entrées de métro offrent, à chaque carrefour de Paris, des exemples si caractéristiques, avec leurs tiges de métal en forme de poireaux mâtinés de lianes exotiques, et leurs oblongues tulipes vaguement obscènes. Les robes de Liane de Pougy et de la comtesse Greffulhe, les jaquettes et les faux-cols de Boni de Castellane et de Robert de Montesquiou, les salons encombrés de palmiers, de peaux de panthères, d'abat-jour à franges de perles, de meubles laqués, de poufs, ombrés de trois épaisseurs de rideaux opaques, tapissés de tentures dans les tons glauques ou feuille morte, les équipages et les premières voitures automobiles, l'Exposition de 1900, avec ses stucs ébouriffants, ses minarets, ses faux Turcs, ses faux Japonais, ses faux Russes et ses vrais pickpockets, les vastes chapeaux en forme de potagers et les ombrelles de dentelle noire, les corsets à taille de guêpe et les bals du Moulin Rouge, Sarah Bernhardt et les grands ducs, tout cela fait tellement partie du folklore aujourd'hui (que dis-je du folklore : de la mythologie !) que ce n'est guère la peine d'y insister.
Gardons-en cependant l'image en mémoire, car beaucoup des aspects de l'homosexualité vers 1900 sont, eux aussi, très « fin de siècle », et s'enrobent de velours, se parfument de Chypre et d'héliotrope, se parent de bijoux « byzantins » et fuient éperdument le grand air.
Car c'est là, à mon sens, que réside essentiellement la différence des mœurs de cette époque et de la nôtre. Nous aimons, nous idolâtrons, même à l'excès parfois, la « nature », la lumière, le soleil, la mer, la montagne, l'oxygène vivifiant et tonique. Notre littérature, notre art, s'accordent avec les goûts des ouvriers, des employés, aussi bien qu'avec ceux des intellectuels et des snobs pour glorifier, les vacances, le sport, les courses éperdues, les épidermes bronzés, la saine odeur des corps en sueur et l'ivresse des bains de minuit.
Nos ancêtres de 1900, eux, ne concevaient la « bicyclette » qu'en pantalons longs, la natation qu'en maillots plus habillés que nos costumes d'été, et les bains de soleil qu'abrités derrière deux épaisseurs d'ombrelles. La « Belle Epoque » est dédiée au culte de la Femme, mais de la Femme mystérieuse, au teint pâle, qui redoute la lumière et le plein air, de la Femme engoncée de corsets et macérée dans la pénombre, telle une idole asiatique. Et cette optique conditionne aussi bien la vie quotidienne, les costumes roides, les voilettes et les rideaux, que la littérature, où l'on doit chercher longuement avant de percevoir un souffle d'air pur.
Cette époque, que nous voyons, avec le recul, si heureuse, fut, en réalité, atrocement pessimiste. Avec le confort, la paix, la prospérité économique, les débuts de l'électricité, du téléphone, de l'automobile, de l'aviation même, avec tout ce qu'il fallait pour vivre sans problème, les maîtres à penser de cette génération eurent l'impression de vivre, non pas l'aube d'un monde meilleur, mais le déclin d'une civilisation ; « fin de siècle » est l'expression qui revient sans cesse sous la plume des littérateurs d'alors ; et l'on se complaisait dans l'étude des décadences, celle de la Rome antique, celle de Byzance ; et l'on recherchait la sensation rare, le bizarre, l'anormal, l'unique ; et l'on se singularisait, et l'on raffinait, et l'on quintessenciait, dans une atmosphère lourde, close, étouffante.
Dans le domaine des mœurs – celui qui nous intéresse ici – cela se traduisait par une affectation de débauches exquises, par l'affichage de vices aussi originaux que possible (mais hélas, la gamme en est vite épuisée !), par des fanfaronnades de névroses extravagantes. On peut dire, sans crainte de se tromper, que pour un homosexuel d'aujourd'hui (j'entends pour un homosexuel « moyen », c'est-à-dire pour celui qui n'est ni prostitué, ni malade, ni travesti dans un cabaret spécialisé), son principal souci est d'affirmer en toutes circonstances, et face à tout le monde, qu'il est « normal », c'est-à-dire que son goût sexuel est un goût naturel, et ne fait nullement de lui un être abject ni une erreur de la création. Or, pour un homosexuel de 1900, au moins dans les milieux cultivés et mondains, la seule façon de faire accepter et excuser sa nature, s'il ne pouvait pas la dissimuler, c'était au contraire d'en exagérer le côté anormal, de poser au Byzantin ou au prince de la Renaissance, de boire l'éther ou de fumer l'opium, de s'afficher avec des bagues de chrysoprase et de cornaline à tous les doigts, et de se faire une réputation de « monstre » ce qui, à cette époque, constituait le dernier mot du chic et du dandysme.
Certes, je généralise. Certes, l'employé de bureau homosexuel qui tremblait d'être découvert et renvoyé ; certes, le soldat homosexuel pour qui le scandale signifiait la prison et le conseil de guerre ; certes, l'ouvrier, le valet de chambre, le cocher homosexuels ne portaient ni bagues ni manteaux doublés en peau de lion (comme celui qu'arborait, avec une exquise simplicité, le comte Robert de Montesquiou). Et même, à n'en pas douter, la bourgeoisie, en son ensemble beaucoup moins évoluée qu'aujourd'hui, surtout en province, abhorrait, détestait, vomissait l'homosexualité beaucoup plus qu'elle ne le fait maintenant. L'hypocrisie des mœurs était plus implacable, et la solitude de ceux de nos semblables qui n'avaient pas la chance d'appartenir à l'aristocratie ou au monde des lettres et du théâtre était affreuse.
Mais il n'en reste pas moins que c'est alors que, pour la première fois depuis l'Antiquité romaine, on vit des hommes oser affirmer leurs mœurs non-conformistes et, presque, s'en glorifier.
Arcadie n°69, n°70, n°71, n°72 et n°73, Marc Daniel (Michel Duchein), septembre, octobre, novembre, décembre 1959 et janvier 1960
(1) Marc Daniel, Hommes du grand siècle, Paris, Arcadie, 1957

/image%2F1477403%2F20150214%2Fob_a07756_banniere-blog-nouvelle-version-2015.jpg)


/idata%2F0051799%2Flogo%2FARCADIE-LOGO.jpg)
/image%2F1477403%2F20180209%2Fob_4b3279_andre-baudry-deces-2018.jpg)