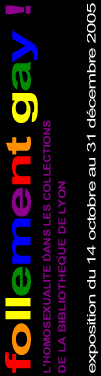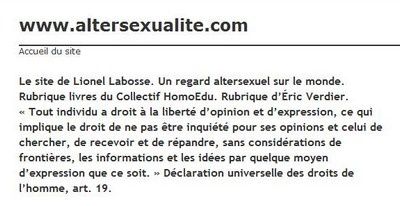Notre Thomas Edward Lawrence par Serge Talbot
 « Lorsque les roues motrices de la seconde machine atteignirent le pont, je levai le bras. Un grondement prodigieux éclata aussitôt et la voie ferrée disparut derrière une colonne de poussière et de fumée noire, haute de cent pieds et large d'autant. De cette ombre jaillirent des craquements effroyables, de longs martèlements métalliques d'acier déchiqueté et une grêle de ferraille ou de tôles ; une roue entière de locomotive tourbillonna soudain hors du nuage, noire contre le ciel et, planant sur nos têtes avec un miaulement musical, retomba lentement et lourdement dans le désert derrière. Puis, un silence de mort, sans cris d'hommes ni coups de feu, s'établit, persista, tandis que la brume grise de l'explosion, dérivant de la voie vers nous, franchissait notre crête pour se perdre dans les montagnes. » (Les Sept Piliers de la Sagesse, p. 458) (1).
« Lorsque les roues motrices de la seconde machine atteignirent le pont, je levai le bras. Un grondement prodigieux éclata aussitôt et la voie ferrée disparut derrière une colonne de poussière et de fumée noire, haute de cent pieds et large d'autant. De cette ombre jaillirent des craquements effroyables, de longs martèlements métalliques d'acier déchiqueté et une grêle de ferraille ou de tôles ; une roue entière de locomotive tourbillonna soudain hors du nuage, noire contre le ciel et, planant sur nos têtes avec un miaulement musical, retomba lentement et lourdement dans le désert derrière. Puis, un silence de mort, sans cris d'hommes ni coups de feu, s'établit, persista, tandis que la brume grise de l'explosion, dérivant de la voie vers nous, franchissait notre crête pour se perdre dans les montagnes. » (Les Sept Piliers de la Sagesse, p. 458) (1).
Cette scène d'Apocalypse s'est répétée bien des fois : les Bédouins, le visage tendu, surveillant la voie de chemin de fer ; le train bondé de soldats Turcs, qui s'avance en soufflant dans la chaleur écrasante du désert ; la mine explosant dans un fracas terrible ; les silhouettes brunes des Arabes bondissant de toutes parts pour un corps à corps avec l'ennemi.
L'homme qui maniait adroitement mines, détonateurs, cordons Bickford, toutes sortes d'engins mortels et compliqués, qui donnait en levant le bras le signal de la destruction, l'organisateur de la révolte arabe contre les Turcs, c'était le fameux Colonel Lawrence (Sidi Lourens », comme l'appelaient familièrement ses chers Bédouins).
Dans un livre extraordinaire, il a raconté l'aventure de sa vie et fait un plaidoyer brûlant pour la cause arabe.
« Les Sept Piliers de la Sagesse sont un récit de guerre et d'aventure et un épitomé parfait de tout ce que les Arabes signifient pour le monde », a dit Winston Churchill.
C'est dans les deux années 1917-1918 que se situe la courte épopée de Lawrence. Le mystérieux Anglais, enveloppé dans ses robes de soie blanche, pieds nus, est alors un homme d'une trentaine d'années, extrêmement vigoureux et endurant, malgré sa petite taille, les yeux bleus, le front haut, le poil blond, lèvres fortes et menton volontaire.
Quelques Anglais, au nombre desquels était Kitchener, Ministre de la Guerre, ayant pensé qu'une révolte des Arabes contre les Turcs permettrait à l'Angleterre de battre la Turquie inféodée à l'Allemagne, cet homme impassible, à la fois chef de guerre et artiste, est devenu l'âme du combat. Comme Byron, il va se sacrifier à la libération d'un peuple opprimé par les Turcs. D'où venait-il ?
Thomas Edward Lawrence est né le 15 août 1888 à Tremadoc, au cœur du Pays de Galles. Dans son livre au titre parlant : Lawrence l'Imposteur (2), Richard Aldington essaya d'expliquer par cette naissance la légende et la personnalité complexe du plus grand aventurier du siècle : le père de Lawrence avait quatre filles de son épouse légitime et cinq fils (dont Thomas Edward était le cadet) d'une autre femme. Le sentiment de cette infériorité sociale aurait poussé Lawrence à romancer ses faits et gestes, à mentir pour se grandir et à s'attribuer une importance qu'il n'avait pas. Ce livre a fait long feu. L'année même de sa parution, Emile Henriot notait : « L'imputation n'est pas recevable. De hautes cautions officielles auraient pu suffire à préserver Lawrence d'une telle critique ». (Le Monde, 8 juin 1955). Et Henriot de rappeler celles de Winston Churchill et du commandant en chef le général Allenby. Et le désir maladif de faire parler de soi, ainsi que la francophobie, constituaient les limitations de l'âme de Lawrence. Mais ce côté adroit n'autorise pas à présenter comme un charlatan et un mythomane l'homme de la Révolte Arabe dans le désert, qui contribua en 1918 à la victoire des Alliés par l'effondrement des Turcs au Moyen-Orient.
Deux ans après le livre d'Aldington paraissait d'ailleurs chez Payot un ouvrage de Mme F. Armitage : Lawrence d'Arabie (3), qui prenait la défense du guerrier solitaire : « Livre sérieux, très attachant et qui témoigne, en même temps que d'une connaissance minutieuse des textes, d'une grande sympathie pour l'auteur des Sept Piliers de la Sagesse P, notait A. Ben Hassen dans l'Action du 2 décembre 1957.
Le livre de Mme Armitage ainsi que celui de Lawrence permettent de saisir l'homme sous l'agent secret.
Thomas Edward est d'abord un enfant heureux, quoique dans un ménage irrégulier. De bonne heure il apparaît comme un garçonnet particulièrement intelligent. C'est un élève brillant et qui a un besoin féminin de séduire. Il passe par Oxford. Lecteur omnivore, il devient très vite amoureux de l'archéologie et se spécialise peu à peu dans l'histoire du Moyen-Orient. Encouragé par l'un de ses professeurs : Hogarth, qui eut dans sa vie une influence majeure, il ira à 22 ans, en Asie Mineure, participer à des travaux de fouilles dans les sites antiques. Les missions archéologiques jouant souvent un rôle dans les Services de renseignements, le jeune oxonien, qui s'habille déjà à l'arabe, se livre avec délices au grand jeu du renseignement. Il a si peu d'argent qu'il prend l'habitude de loger chez l'habitant. Installé au milieu des enfants, des chèvres, des poules, il prend le repas de pain et de lait caillé.
« Son aspect ne changera guère, dit Willy Bourgeois : des cheveux blonds très fins, des yeux bleus tour à tour inquiets et perçants, des sourcils broussailleux, un menton volontaire. » (Lawrence, Roi secret de l'Arabie, p. 13) (4).
« La bouche sinueuse, note de son côté Jean Béraud-Villars, avait au repos une courbe inquiétante : cruauté ? ironie ? mensonge ? mais elle était généralement déformée par un sourire crispé. » (Le Colonel Lawrence, ou la recherche de l'absolu, p. 20) (5).
Ce pur Anglais n'a pas le mépris de l'indigène, du « native ». Il aime à écouter pendant des heures, sur le chantier, les histoires des terrassiers bédouins, à jouer avec eux, faire tomber les barrières qui séparent l'Occident du menu peuple oriental.
« Peu de temps après son arrivée à Carchemish, il se lia d'une amitié très tendre avec un certain Sheik Ahmed, surnommé Dahoum le Noir. Ce garçon d'une quinzaine d'années était assez intelligent, calme, doux et très beau. On trouve parfois chez les Arabes des hommes dont le corps et le visage sont d'une beauté antique et qui, au lieu du nez busqué, des mollets maigres et des grands pieds plats des Bédouins, ont le nez droit, les muscles longs et les attaches fines des Antinoüs classiques... L'Arabe devint son compagnon habituel, son « âme-sœur » (kindred spirit), dit assez curieusement David Garnett. Les deux hommes ne se quittaient plus, faisaient de longues randonnées dans la campagne demi-déserte, nageaient ensemble et jouaient dans l'eau comme de jeunes chiens. » (Jean Béraud-Villars, ouvrage cité, p. 51).
Thomas Edward sculpta de Dahoum, dans la pierre tendre du pays, une statue qui le représentait tout nu.
« Il y avait un autre indigène auquel Lawrence montrait beaucoup d'amitié. C'était le contremaître du chantier de Carchemish, un certain Sheik Hamoudi, surnommé le Hoja, personnage des plus pittoresque. Jeune, il avait mené une vie peu édifiante, couru le désert pour détrousser les voyageurs et commis un certain nombre de meurtres. Devenu plus calme avec l'âge, il avait une trentaine d'années à l'époque où Lawrence le rencontra... » (Id., p. 52).
A propos de ces affections, que Thomas Edward se plaisait à afficher, Béraud-Villars cite l'Anabase : « Parfois un soldat passait en fraude quelque bel enfant, quelque belle femme, dont il était épris. » (IV, 12). Lawrence, lui, se contentait des beaux enfants !
Ses pérégrinations en Syrie en compagnie de ses deux amis Arabes sont mal connues : « J'aimais les choses inférieures ; c'est vers le bas que je cherchais mes plaisirs ou mes aventures... Je gardais encore l'arrière-goût de liberté laissé par deux semaines de ma jeunesse dans les bas-fonds de Port-Saïd. » (Les Sept Piliers, p. 703).
Pour de courtes vacances prises en 1913, le jeune archéologue ramena chez lui à Oxford Sheik Ahmed et le Hoja.
« Lawrence prenait plaisir à choquer les préjugés raciaux de ses compatriotes, pour ne parler que de ceux-là et pendant plusieurs semaines, promena deux Arabes en robe du désert qui soulevaient quelque réprobation dans la prude et traditionnelle ville universitaire. » (Béraud-Villars, p. 60).
Oxford avait fait de Lawrence un esthète raffiné, ami du paradoxe. En Orient les paysages pétrifiés qu'embrase le perpétuel incendie du soleil, les déserts parcourus à pied et à dos de chameau lui permettent de mesurer son endurance physique et de faire l'apprentissage des grands espaces primitifs. Cet Anglais imaginatif savait « regarder vaguement, à travers les paupières mi-closes, le rayonnement essentiel des choses » (Sept Piliers, p. 167). « L'Orient et l'Occident appartiennent à Dieu. Vers quelque lieu que se tournent nos regards, vous rencontrerez sa face. Il remplit l'univers de son immensité et de sa science », dit le Koran en un verset magnifique (III, 97).
Peu à peu, jusqu'en 1914, il apprend à connaître l'âme arabe. Il étudia les mœurs, les populations, leurs dialectes et leurs problèmes. Toujours il aimera la minceur brune et nerveuse des Arabes et leurs yeux pensifs, parfois fardés de kohl. Jamais, dans les souvenirs de ses expéditions les plus aventureuses, ne cesse de transparaître l'élément sensible : « Le plus jeune, Rahail, éveilla surtout mon attention... Sa bouche était petite et gonflée en bouton, son menton très pointu. Ceci ajouté à un front haut et fort et à des yeux agrandis par le kohl lui donnait un air mélangé de pétulance, d'artifice et de soumission basse, volontairement imposée à un orgueil fondamental. » (Sept Piliers, p. 432).
La guerre mobilise Lawrence au service des renseignements de l'Etat-Major du Caire. A Londres, il a des amis mystérieux et puissants. Il est envoyé en Arabie pour hâter la désorganisation de l'Empire Ottoman, mission exaltante pour cet agitateur-né, qui avait pour l'intrigue un amour diabolique.
Grâce à sa parfaite connaissance des gens et des choses, grâce à son mimétisme, à l'effort d'adaptation qu'il fit sur lui-même au point de vivre, de s'habiller, de parler et de penser comme les nomades, le jeune intellectuel aux préoccupations purement spéculatives se transforma en l'archétype de l'aventurier moderne. Nullement militariste, il s'entendait mal avec l'État-Major anglais. Il effectua sa mission seul, selon ses propres vues, entraînant les farouches guerriers arabes par ses promesses et son audacieuse bravoure, mais avare de la vie de ses hommes. En cet étrange infidèle, héros du baroud et distributeur d'or anglais aux sheiks nomades, ces hommes ombrageux avaient une confiance totale.
L'homme de son destin fut Fayçal, fils du chérif Hussein, émir de La Mecque. Lawrence le rencontra au camp d'Hamra, grosse bourgade au Nord-Ouest de Rabegh, dans une longue maison aux murs de boue séchée bâtie au sommet d'un monticule rocailleux :
« J'aperçus alors, dans l'encadrement noir d'une porte, un personnage vêtu de blanc qui me regardait avec attention. C'était, je le compris au premier coup d'œil, l'homme que je cherchais en Arabie – le chef qui dresserait la Révolte Arabe en pleine gloire. Dans ses longues robes de soie blanche avec, sur la tête, un voile brun retenu par une cordelette de pourpre et d'or, Fayçal était semblable à une colonne très haute et très mince. Il gardait les paupières baissées, sa barbe noire et son visage sans expression surmontaient d'une sorte de masque l'étrange vigilance immobile de son corps. Ses mains étaient croisées devant lui sur son poignard...
Comment trouvez-vous notre camp ?...
Superbe, mais bien loin de Damas. »
« Le mot tomba au milieu du groupe comme une épée. » (Les Sept Piliers, p. 110).
Lawrence décrit avec beaucoup de talent la splendeur barbare de l'armée de Fayçal :
« En tête s'avançait Fayçal, vêtu de blanc, à sa droite, Charraf coiffé d'une kouffiè rouge, enveloppé d'une gandourah et d'un caftan teints au henné ; à sa gauche moi-même en blanc et rouge. Puis venaient trois bannières, lances dorées et soie d'un cramoisi fané ; les tambours derrière elles jouaient une marche, enfin arrivaient la masse farouche des 1200 Akhaïlats de la garde aussi proches les uns des autres que le permettait le terrain, les hommes en habits multicolores, les bêtes presque aussi brillantes sous la polychromie de leurs harnachements. Nous emplissions à pleins bords la vallée de notre flot étincelant. » (Sept Piliers, p. 177).
Officiellement simple agent de liaison auprès de Fayçal, « Sidi Loureras » décide des campagnes, les organise. A la tête d'une harka il accomplit des coups de main en vrai pirate du désert. Contre toute vraisemblance, il s'empare du port d'Akaba, dernière base importante en possession des Turcs sur la Mer Rouge. Il dynamite des ponts sous la mitraille. Il fait sauter les trains sur la ligne de Médine. Avec une poignée de méharistes, il coupe les lignes de communication des Turcs à travers le Hedjaz.
L'aventure personnelle ne perd pas ses droits. Ainsi du 5 au 19 juin 1917, Thomas-Edward fit en Syrie une randonnée solitaire, dont il n'a parlé qu'avec la plus grande réticence :
« On ne peut faire que des hypothèses sur une expédition qui fut probablement l'une des plus hasardeuses et des plus romanesques de Lawrence et supposer, quoique rien ne le prouve, qu'il l'entreprit, en partie tout au moins, pour revoir après de longs mois de séparation, un ami inconnu et mystérieux, être aimé ou agent politique, qu'il avait laissé en Syrie et dont il a parlé à plusieurs reprises, aussi bien dans les Sept Piliers que dans ses lettres personnelles. » (Béraud-Villars, o.c., p. 181).
Rendu à la vie civile en 1935, il pensait se consacrer à la littérature. Il avait publié une traduction de l'Odyssée. Il avait pour la mécanique, surtout pour les motocyclettes, la même dangereuse passion qu'aura James Dean vingt ans plus tard. Il eut la même fin.
Si tous les hommes – tel Nansen qui mourut sur la banquise – avaient une mort qui ressemblait à leur vie, Lawrence aurait dû quitter les rivages de la lumière dans un décor des Mille et Une Nuits. Pourtant cet homme exceptionnel eut, en Angleterre, une mort stupidement banale, sous un ciel de pluie.
Le 13 mars 1935, il revenait, sur la moto que lui avait offerte l'écrivain Bernard Shaw, de la poste de Bovington. En allant à toute allure sur la route détrempée sa moto dérapa et il se tua, ayant voulu éviter, au sommet d'un dos d'âne, deux jeunes cyclistes.
C'est au cimetière de Moreton que fut enterré très simplement, dans un pauvre cercueil de sapin dépourvu de toute inscription, le roi non-couronné de l'Arabie, dont l'idéal généreux s'était brisé sur la dure réalité des conflits entre les hommes.
L'Angleterre a mis officiellement le héros du désert au rang de ses grands hommes, en plaçant son buste dans la crypte de la cathédrale Saint-Paul à Londres.
Jamais l'Intelligence Service ne révélera quel fut son rôle secret. Quant à sa personnalité complexe elle est loin d'avoir livré tous ses mystères. Jean Béraud-Villars (que j'ai souvent cité) s'est efforcé de recouper Lawrence dans ses écrits, sa correspondance, ses entretiens rapportés, les témoignages de ceux qui l'ont connu.
« Les treize ans que Lawrence consacra à une vie de simple soldat, écrit-il, suffisent à cautionner sa bonne foi. Nul imposteur n'aurait fait de tels sacrifices pour faire croire à son imposture. » (ouvrage cité, p. 388).
Ce portrait plausible, humain, fruit de plusieurs années de travail, œuvre d'un homme hostile à la politique orientale de Lawrence mais objectif et mesuré, est le meilleur qui ait été fait de Thomas-Edward jusqu'à ce jour.
La tradition à peu près constante fait de Lawrence un homosexuel. Cependant, contre l'évidence, certains de ses amis ont affirmé qu'il n'en était rien et que sa vie avait été chaste. Sans oser se prononcer tout à fait, Béraud-Villars, qui note les analogies entre Lawrence et Gide, reconnaît qu'il « était certainement dans sa nature intime un homosexuel » (o.c., p. 353).
Il n'a jamais caché son éloignement à l'égard des femmes. Dans la dernière partie de sa vie, il a cherché refuge dans un lieu anti-féminin entre tous : une chambre de caserne. Son intimité avec Dahoum est de toute évidence gidienne. Toutes ses affections ont été masculines.
La dédicace des Sept Piliers au mystérieux S. A. pose aux érudits un problème analogue à celui de la dédicace des Sonnets de Shakespeare à un certain W. H., le Begetter, l'Inspirateur, dont, malgré toutes les recherches, la personnalité est restée inconnue.
Faut-il identifier S. A., comme Béraud-Villars, à « un jeune intellectuel damasquin que Lawrence connu lors de ses contacts avec les révolutionnaires syriens ? Faut-il l'identifier, comme Graves et A. W. Lawrence à Sheik Ahmed (Dahoum) ? En tout cas tous ceux qui ont connu Thomas-Edward pensent que S. A. était un homme. Or cette admirable dédicace ne laisse pas subsister de doute sur l'homosexualité du plus grand conquérant du XXIe siècle :
« Je t'aimais, c'est pourquoi, tirant de mes mains ces marées d'hommes, j'ai tracé en étoiles ma volonté dans le ciel.
Afin de te gagner la liberté, la maison digne de toi, la maison aux sept piliers : ainsi : tes yeux brilleraient peut-être pour moi.
Lors de notre arrivée...
L'Amour, las de la route, tâtonna jusqu'à ton corps, notre bref salaire, nôtre pour l'instant. »
Comme un héros stendhalien, un Julien Sorel, un Lucien Leuwen, il mène, a dit Béraud-Villars « la vieille lutte de l'intelligence, du caractère, de l'égotisme, contre le conformisme.
A Akaba, c'est un grand personnage : sa garde privée est composée de jeunes Arabes âgés de seize à vingt-cinq ans, très fiers de leur rôle et traitant de haut les autres Bédouins et même les officiers britanniques. Toute sa vie d'ailleurs, il exerça sur certaines âmes un étrange magnétisme.
Pourtant le héros du désert est obsédé de scrupules, car il a promis l'indépendance aux Arabes et il comprend qu'on ne la leur accordera pas : déjà le gouvernement anglais se livre à des accords de partage secrets et fait aux Sionistes des promesses inconciliables avec celles faites aux chefs arabes. Tout est inutile. La seule valeur du sacrifice volontaire est de grandir celui qui le fait : « Il y a des qualités comme le courage qui ne peuvent pas se manifester seules : elles n'apparaissent que mêlées à un médium, bon ou mauvais. » (Sept Piliers, p. 704).
Le 11 septembre 1918 il entre à Damas, perle de la Syrie, où il a préparé à Fayçal une entrée spectaculaire, pour que les Arabes puissent parler en alliés victorieux et constituer un Etat national. Quand apparut Lawrence, enveloppé dans ses robes de soie blanche, la foule explosa d'enthousiasme :
« Damas devint folle de joie. Les hommes lançaient en l'air leurs turbans, les femmes déchiraient leurs voiles. Les locataires, aux fenêtres, jetaient des fleurs devant nous, des tentures, des tapis, et leurs épouses se penchant avec des éclats de rire derrière les grillages, nous éclaboussaient de parfums. » (Sept Piliers, p. 803).
Mais, pour Lawrence, le cœur n'y était plus : « Quand une chose était à ma portée, a-t-il écrit, je n'en voulais plus. Ma joie était dans le désert. A (Sept Piliers, p. 705).
Un coup très dur lui avait été porté à Deraa, où, stupidement, il fut surpris et arrêté par une patrouille turque qui le prenait pour un déserteur circassien. On le mena devant le gouverneur : « C'était un homme énorme, circassien lui-même, peut-être ; assis sur le lit en pyjama, il tremblait et suait comme dans un accès de fièvre... Au sommet de son crâne se dressait une chevelure hérissée, pas plus longue que le chaume noir de ses joues et de son menton... »
Le gros homme attira Thomas-Edward dans ses bras sur son lit, le cajola, disant qu'il était blanc et frais, lui ordonna de quitter son pantalon, et comme l'autre le repoussait, il appela ses hommes qui déchirèrent lambeau à lambeau les vêtements du soi-disant déserteur, puis le bey vint, une lueur dans les yeux, le tripoter par tout le corps. Lawrence le supporta jusqu'au moment où il devint trop ignoble. Alors, il lui flanqua son genou dans le ventre.
Furieux, le Bey, plié en deux et grondant de douleur, fit maintenir sa victime, lui enfonça les dents dans le cou et lui lacéra la peau le long des côtes avec une baïonnette.
« Le sang coulait le long de mes côtes et tombait goutte à goutte sur le devant de ma cuisse. Le Bey eut l'air d'y prendre beaucoup de plaisir et en aspergea mon ventre avec la pointe de ses doigts. »
En fin de compte, il dit à ses hommes d'emmener le prisonnier et de « faire son éducation ».
Thomas-Edward étendu sur un banc, maintenu par quatre gardes, fut fouetté jusqu'à l'évanouissement. Heureusement, il eut le courage de se plaindre en arabe jusqu'au moment où il s'évanouissait et les Turcs ne surent jamais qu'ils avaient mis la main sur le redoutable Anglais.
« Je me souviens plus tard que le caporal m'avait fait lever d'un coup de sa botte cloutée... Je me souviens aussi de lui avoir souri stupidement : une chaleur délicieuse, probablement sexuelle, se gonflait en moi et me traversait. Soudain il leva le bras et me sabra de toute la longueur de son fouet, dans l'aine. Le coup me cassa en deux, hurlant ou, plutôt, essayant en vain de hurler haletant d'horreur par ma bouche ouverte. L'un des soldats gigota de joie. Une voix cria : « Diable ! tu l'as tué ! ... »
« A en juger par les meurtrissures ils durent me battre encore, mais je ne me souviens plus que d'avoir été traîné par deux hommes, chacun d'eux me tirant une jambe comme pour m'écarteler pendant qu'un troisième me chevauchait. »
Quand ils le ramenèrent sanglotant et criant grâce, dans la chambre du Bey, celui-ci le rejeta en hâte :
« J'étais une loque trop sanguinolente pour son lit... Le caporal tout penaud, choisi pour sa jeunesse et sa bonne apparence, dut rester dans la chambre tandis que les autres m'emportaient par l'escalier étroit jusque dans la rue... » (Sept Piliers, pp. 551-555).
Le soir du troisième jour, Thomas-Edward parvint à s'enfuir par une porte mal fermée. Son corps n'était plus qu'une plaie. Après ce supplice, ses compagnons notèrent une sorte de fêlure dans sa personnalité.
Mais plus encore que cet épisode digne de la Série Noire, ce furent les marchandages des Alliés sur le dos des Arabes qui achevèrent de briser ses ressorts intérieurs. Sa position en Arabie était aussi fragile que considérable. Trois jours après son entrée triomphale à Damas, il en repart et rentre en Angleterre. Il participe à la Conférence de Versailles, défendant les droits des Arabes. Il obtint des succès temporaires en plaçant ses amis sur les trônes qu'ils convoitaient. Mais cela ne dura pas.
Le héros du désert renvoya au Roi toutes ses décorations et démissionna.
Pour fixer sa campagne d'Arabie dans une prose magnifique et pour plaider devant l'Histoire la cause de ses amis, il écrit les Sept Piliers de la Sagesse, vivant de pain, de beurre et d'eau. Il collabore avec Churchill au service du Moyen-Orient, il est envoyé comme plénipotentiaire au Hedjaz, à Aden, à Jérusalem. « Si d'autres hommes créaient, je voulais bien me mettre à leur service pour raccommoder leur œuvre ; car si la création est un péché, la création d'un estropié ou d'un borgne est à la fois péché et honte. » (Sept Piliers, p. 704).
En 1922, surprise : Lawrence se démet de ses fonctions, refuse les situations brillantes, et, pendant treize ans, dégoûté des grandes initiatives, il se fait simple soldat sous des noms d'emprunt, Ross ou Shaw : « Un esclavage volontaire est l'orgueil le plus profond d'un esprit morbide, et la douleur subie par la faute d'autrui, son plus joyeux honneur. » (Sept Piliers, p. 704).
Lawrence est pauvre « pour avoir trop acheté de livres, de tableaux, de motos », mais quand son livre sera normalement édité, il refusera de monnayer et sa gloire et tout le sang qu'avait fait couler la guerre d'Arabie.
Au Royal Tank Corps ou dans la R.A.F., l'homme qui avait été le roi secret de l'Arabie, Lawrence le destructeur de trains, travaillait comme plongeur au mess des sous-officiers. En dépit de son orgueil, de son goût du « canular », de ses partis-pris, de son amour de l'intrigue, Thomas-Edward force l'admiration par son désintéressement, son idéalisme, son amour des pauvres gens.
Il haïssait la routine du soldat en temps de paix, la rude discipline anglaise, la promiscuité des chambrées, mais il était convaincu que c'était pour lui un excellent moyen d'échapper au poids de son passé et de retrouver la paix intérieure.
Près du camp de Bovington, il avait remis en état une minuscule masure. Elle devint son refuge et il y eut autour de lui « une petite cour de jeunes hommes attirés par le prestige de son intelligence et sa personnalité magnétique » (Béraud-Villars, p. 361).
« Dans les rares occasions où des amis « du siècle » étaient invités dans cette Thébaïde, ses jeunes vassaux s'affairaient dans la maison, frottaient le dallage, faisaient briller les cuivres, chauffer l'eau du thé et, pendant la visite, se tenaient déférents et silencieux autour du peintre ou du poète célèbre qui était venu voir leur idole. Mais si l'un de ces étrangers au monde des soldats se présentait sans être prié et surprenait Lawrence au milieu de ses camarades, Thomas-Edward cachait mal sa colère, l'intrus se sentait tombé dans un cénacle hostile et n'avait qu'à s'en aller. » (Id., p. 361).
Comme Walt Whitman, Lawrence, jusqu'à la fin de sa vie était heureux de se trouver avec des gens d'une classe sociale modeste : « On le rencontrait avec d'étranges compagnons au visage inquiétant et tout un côté de sa vie semble être resté secret. » (Id., p. 389).
« Avant que la main molle de la terre n'explore ta forme et que les vers aveugles ne s'engraissent sur
Ta Substance. »
C'est à ce dédicataire inconnu, mort avant l'entrée à Damas, que s'adressent les dernières lignes de l'ouvrage, dans lesquelles Lawrence déclare que le plus puissant des motifs qui l'avaient fait agir, d'un bout à l'autre, avait été « un motif personnel, que je n'ai pas mentionné dans ce livre, mais qui me fut présent, je pense, chaque heure de ces deux années. » (Sept Piliers, p. 821).
Plus nette encore – s'il est possible – cette déclaration de Thomas-Edward :
« L'Arabe est par nature continent ; et l'usage d'un mariage universel a presque aboli dans ses tribus les errements irréguliers. Les femmes publiques des rares centres humains que nous rencontrions dans nos mois d'errance n'auraient rien été pour notre foule, en admettant que leur chair harassée fût acceptable pour un homme sain. L'horreur d'un commerce aussi sordide nous fit user avec indifférence, afin d'éteindre nos rares ardeurs réciproques, de nos corps jeunes et lavés – commodité froide qui, par comparaison, apparaissait asexuelle et presque pure. Plus tard quelques-uns d'entre nous se mirent à justifier cet acte stérile et affirmèrent que deux amis, frissonnant dans un creux de sable à l'enlacement intime de leurs corps brûlants, trouvaient, caché dans l'ombre, un adjuvant sensuel à la passion mentale qui soudait nos esprits et nos âmes en un seul effort flamboyant. » (Sept Piliers, p. 39).
Dans les Sept Piliers, Lawrence « relie, dit Béraud-Villars, le récit de ses expériences de guerre à sa vie antérieure, toute chargée pour lui des souvenirs d'une jeunesse libre et heureuse dans une Arcadie syrienne. » (o. c., p. 331).
Entrelacée aux hauts faits de l'épopée de Lawrence se trouve une touchante version arabe des « Amitiés Particulières », l'histoire de Farraj, un adolescent au corps de jeune fille, et de son ami Daoud, vigoureux et viril.
L'histoire débute au cours d'un arrêt, pendant l'expédition contre Akaba. Le jeune Daoud demande au héros du désert d'intervenir en faveur de son ami Farraj, que son chef Saad allait fouetter parce qu'il avait mis le feu à leur tente dans un accès d'espièglerie. Lawrence intercède en faveur du garnement mais tout ce qu'on peut lui accorder est de laisser Daoud prendre sa part du nombre de coups :
Daoud sauta sur la proposition, baisa ma main puis celle de Saad et remonta la vallée au galop. Saad, alors, me raconta en riant l'histoire du couple. C'était un exemple, entre jeunes Orientaux, de ces affections que l'absence de femmes rend inévitables. Ces amitiés d'adolescents conduisent souvent à des amours viriles d'une profondeur et d'une force qui dépassent de loin nos vaniteuses obsessions charnelles. » (Sept Piliers, p. 297).
Le lendemain « au milieu des rires, arrivèrent pour nous saluer deux personnages courbés et clopinants, de la douleur encore dans les yeux mais un sourire rusé sur les lèvres. C'étaient Daoud l'impétueux et son « ami » Farraj : un magnifique adolescent avec un corps de jeune fille, un visage innocent et lisse et des yeux noyés. Ils venaient, dirent-ils, se mettre à mon service. » (p. 297).
Séduit par leur jeunesse et leur propreté, Thomas-Edward les engage tous les deux, et ils mènent à ses côtés, ce que Pétrarque appelle « la vie misérable et intrépide des amants ».
C'étaient, nous dit cet Occidental de fine race, « deux êtres ensoleillés que n'avait pas encore glacés l'ombre du monde – les mieux nés et les plus enviables que j'aie jamais connus... Leur faute était une joie de lutins, l'insouciance d'une jeunesse sans mesure, la faculté d'être heureux précisément quand nous ne l'étions pas. » (Sept Piliers, p. 389).
Ils avaient plus de bravoure et de gaieté que la moyenne des domestiques arabes... J'aimais la liberté qu'ils gardaient avec moi et j'admirais leur entente devant les exigences de la vie. » (p. 305).
Tous les deux devaient mourir au service de Lawrence.
Au cours de la dure campagne d'hiver qui suivit la prise de Jérusalem par le général Allenby, ils se trouvaient à Azrag, oasis isolée à la hauteur d'Amman, mais beaucoup plus à l'est dans le désert. Il neigeait presque chaque jour. Ou alors une pluie opiniâtre relayait les flocons glacés. Dans leurs robes légères les Arabes grelottaient. Daoud mourut de froid. Il s'en alla dans ces « jardins où coulent des fleuves, goûter les fruits enchantés que le Prophète promet à ceux qui croient (Koran, chap. II, verset 23).
Lawrence était à Chobek avec l'émir Nacer, cousin de Fayçal, quand Farraj le lui apprit :
« Ils avaient été amis dès l'enfance, dans une éternelle gaieté ; travaillant ensemble, dormant ensemble, partageant leurs bénéfices et leurs gains avec l'honnête franchise d'un amour parfait. Aussi, ne fus-je pas étonné de voir Farraj vieilli, le regard plombé, le visage sombre et dur. Dès ce jour jusqu'à la fin de son service il ne nous fit jamais plus rire. Il soignait minutieusement, plus encore qu'autrefois, mon chameau, le café, mes habits et mes selles et faisait chaque jour, régulièrement, ses trois prières. Les autres s'offrirent pour le réconforter, il s'éloigna, au contraire, errant sans répit, silencieux, gris et très seul. » (Les Sept Piliers, p. 633).
Jamais plus il ne connaîtrait les joies des amis : « frissonnant dans un creux de sable à l'enlacement intime de leurs corps brûlants ».
Alors qu'il revenait d'Atara, lors de l'offensive manquée d'Allenby sur Salt, Lawrence n'hésita pas à pénétrer dans Amman, déguisé en bohémienne et accompagné de Farraj, lui aussi habillé en femme :
« Cette visite eut un plein succès, quoique infructueuse, car je décidai qu'il fallait laisser la place tranquille. Il y eut un moment désagréable, près du pont, pendant notre retour. Nous rencontrâmes quelques soldats turcs, qui, se fiant aux apparences, se montrèrent un peu trop pressants. Faisant preuve en cette circonstance, d'une réserve et d'un coup de jarret inhabituels aux bohémiennes, nous sortîmes intacts de l'aventure. » (Sept piliers, p. 641).
Si elle leur donne des joies d'orgueil immense, l'aventure expose en revanche ceux qu'elle mène à de cruelles expériences. Au cours de l'été 1918, elle obligea Lawrence à achever, d'un coup de revolver dans l'oreille, Farraj, blessé intransportable, et qu'on ne pouvait laisser aux mains des Turcs, qui brûlaient vivants les malheureux blessés :
« Je m'agenouillai à côté de lui, tenant mon pistolet contre le sol, près de sa tête, pour qu'il ne devinât pas mon dessein. Mais il dut le deviner, car il ouvrit les yeux et me saisit de sa main rêche et calleuse, la petite main des adolescents du Nedjed. J'attendis un instant. Il dit : « Daoud ne sera pas content de vous », tandis que le vieux sourire revenait étrangement sur son visage gris et crispé : « Saluez-le de ma part », répondis-je. Il me rendit la réponse consacrée : « Dieu vous donnera la paix », et ferma enfin les yeux avec fatigue. » (Sept piliers, p. 643).
Il reste certainement beaucoup à dire sur T. E. Lawrence, « personnalité mystique immesurable », selon le mot de W. Churchill. Espérons que paraîtra un jour le livre complet, exhaustif, que nous attendons.
Arrêtons-nous, pour le moment, sur cette image : Une vallée de sable rouge parsemée de mica éblouissant, l'air qui vibre au bruit d'une fusillade proche... Le guerrier solitaire est agenouillé à côté de Ferraj. Le vent du désert joue dans les plis de sa large robe blanche. Son haïk mauve, fixé sur son front par deux brides de cuir serrées dans des fuseaux d'or, couronne son visage pétrifié, sur lequel la chaleur de fournaise met comme un masque de métal. Ses yeux bleus, d'une transparence animale, regardent Farraj, couché sur le ballast, qui attend le coup de grâce.
« L'amour vient de Dieu, appartient à Dieu et tend vers Dieu », est-il écrit dans les Sept Piliers (p. 444).
(1) Les Sept Piliers de la Sagesse (Seven Pillars of Wisdom), par T.-E. Lawrence, Payot, 1958, trad. de Charles Mauron.
(2) Lawrence l'Imposteur, par Richard Aldington, Amiot-Dumont 1955, trad. Marchagay, Rambaud et Rosenthal.
(3) Lawrence d'Arabie, par F. Armitage, Payot, 1957.
(4) Lawrence, Roi secret de l'Arabie, par Willy Bourgeois, Gérard et Cie (Belgique), 1958.
(5) Le Colonel Lawrence, ou la recherche de l'absolu, par Jean Béraud-Villars, Albin-Michel, 1955.
Arcadie n°71, Serge Talbot (pseudo de Paul Hillairet), septembre 1959

/image%2F1477403%2F20150214%2Fob_a07756_banniere-blog-nouvelle-version-2015.jpg)


/idata%2F0051799%2Flogo%2FARCADIE-LOGO.jpg)
/image%2F1477403%2F20180209%2Fob_4b3279_andre-baudry-deces-2018.jpg)