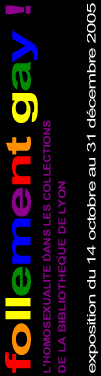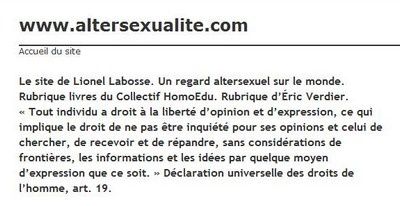En marge du centenaire de Han Ryner : La fille manquée (1903) par Robert Amar
 « Le plus étonnant retourneur de mots et d'idées que je connaisse » écrivait Jean Aicard, dès 1889, du conteur et romancier Han Ryner, dont on vient, en Sorbonne, de fêter le centenaire.
« Le plus étonnant retourneur de mots et d'idées que je connaisse » écrivait Jean Aicard, dès 1889, du conteur et romancier Han Ryner, dont on vient, en Sorbonne, de fêter le centenaire.
Dans le Comité de cette juste commémoration, on trouve, à côté de Charles Baudouin, président des amis de l'auteur, André Billy, André Chamson, Georges Duhamel, Jean Giono, Jean Rostand, parmi beaucoup d'autres.
Guetteur attentif, Han Ryner était à l'affût de tout ce qui heurtait sa nature généreuse ; avec la finesse de son observation et la puissance de son verbe, il partait à l'attaque des bastilles du conformisme et du dogmatisme. Son « œuvre » énorme dépasse infiniment l'acception littéraire de ce terme car elle est tout à la fois pensée et action.
Dans le champ de sa vision – si large fût-elle – l'homosexualité aurait pu ne pas se trouver ; par chance, elle le fut. Et c'est ce qui nous vaut, daté de 1903 et publié chez l'éditeur Genonceaux, un roman : La Fille Manquée (1903).
Comme Ibsen qui disait : « Mon rôle est de poser les problèmes ; à chacun de les résoudre pour soi-même », il y attirait l'attention d'un large public sur un comportement qui, pour n'être pas celui de la majorité, n'en existe pas moins et mérite la compréhension.
En décrivant un cas, avec une sensibilité digne de son sujet, il sut troubler la « bonne conscience » de beaucoup, en suggérant tout ce qu'il y avait d'injuste dans leurs jugements.
Cela se passait en 1903, avons-nous dit ; une telle prise de position – qui n'était en rien un plaidoyer pro domo – constituait alors une bonne et courageuse action. Arcadie ajoute ses raisons personnelles à toutes les autres en s'associant, avec gratitude, à ce centenaire.
Au surplus, en relisant pour nos lecteurs ce roman devenu introuvable et en reprenant le récit avec un certain détail, pour ce motif même, sommes-nous assurés de les intéresser comme nous le fûmes nous-mêmes : par le fond, certes, mais aussi par une forme très classique qui le fait échapper au sort de la plupart des productions de cette époque, le style nous les faisant tomber des mains.
Rarement on a vu analyser avec une telle pénétration psychologique l'éveil et le développement de l'amitié de collège sous ses différents aspects ; avec beaucoup de délicatesse mais aussi avec une précision qui ne serait plus permise aux écrivains d'aujourd'hui : preuve supplémentaire du recul certain de la liberté d'expression.
Le récit est écrit à la première personne, constitué par les cahiers intimes de François de Taulane. Dès l'abord apparaît l'intention de l'auteur, nous disant qu'un vers d'Alfred de Vigny :
« L'homme a toujours besoin de caresse et d'amour. »
se retrouve souvent en haut des pages, en bas, dans la marge, à toutes les places libres.
« Il nous a semblé parfois une excuse murmurée, parfois un sanglot qu'on retient, plus souvent un grand cri venu du fond de l'abîme, un appel qui n'espère pas. »
François n'a pas connu ses parents, morts alors qu'il n'était qu'un bébé ; il n'a d'eux que des portraits, rendus vivants par une longue contemplation et ce qu'on lui a conté sur eux. Mais lorsque ses rêves construisent une enfance douce, c'est dans les bras de son père qu'il se sent bercé et c'est son regard qui le fond de tendresse, sa mère ne lui inspirant que de la frayeur.
C'est au foyer de son tuteur qu'il va vivre désormais, l'oncle Bertrand (que ses premiers frôlements de félin sauvage et ses élans à l'assaut des baisers n'étonnent pas), la tante Désirée, une orgueilleuse et intolérable femelle, leurs deux filles, Louise – son aînée de six ans – qui le bouscule et le bat, Elisabeth – Lisa – de son âge, dont la douceur n'est qu'apparente, lui imposant les rôles les plus déplaisants et inventant des jeux pour l'humilier et le tourmenter.
Sous ces trois espèces, la femme lui apparaissait comme un tyran rude et sournois, une créature intolérante et intolérable. Il ne lui échappait que le soir lorsque, longuement, dans son lit, il savourait le calme et pouvait appeler les rêves conscients à son secours. « Je couchais parfois auprès d'un père, mon corps tout de joie tiède, pelotonné contre une grande tendresse protectrice ; d'autres fois, je me pressais le long d'un frère, mêlé à lui en une étreinte. »
C'est dans ces dispositions d'esprit que, frêle et maladif, il fut envoyé dans une petite ville de Provence, en pension à l'Institution Saint-Louis-de-Gonzague. Une vraie délivrance ; car « la règle, pour celui qui échappe à des tyrannies capricieuses, s'appelle liberté ».
Une vaste maison, des cours avec des allées de vieux platanes formant terrasse sur la mer ; là, les élèves – une centaine d'internes – menaient la vie dure au pion et aux professeurs sans rien risquer car le directeur, très attaché à ses intérêts, les renverrait, eux, plutôt qu'un seul élève.
L'heure triste était celle du soir, survenant après celles de la clarté et de la gaieté ; s'il pleurait dans son lit, c'était par nostalgie de l'inconnu, non par nostalgie du passé : « Ce que mes sanglots appelaient, c'était toujours la caresse. »
Les tapotements sur la joue, les bons sourires et les bonbons de l'abbé Saurien, le directeur, le satisfaisaient sans le contenter : il aurait voulu pouvoir lui demander les baisers que son oncle ne lui refusait pas. Se découvrirait-il en confession ? Il n'osait, imaginant les réponses opposées qui lui seraient faites.
D'autres fois c'étaient des caresses fraternelles qui embellissaient ses rêves, annonciatrices – il le sentait obscurément – de joies plus frémissantes.
D'ailleurs, au dortoir, il avait l'impression qu'un mystère l'entourait, fait de chuchotements, de rampements, de bruits indistincts, malgré le pas régulier du pion en surveillance et plus encore lorsqu'il s'enfermait dans son alcôve et que la dernière lumière s'éteignait.
Il ne tarda pas à s'apercevoir que, durant le jour, derrière les platanes des cours ou, en étude, à l'abri des pupitres relevés, des baisers s'échangeaient sans réserve ; que les creux des vallons ou les rochers étaient de propices abris pendant les promenades du jeudi et du dimanche que suivaient aussi quelques anciens élèves, étrangement restés attachés à leur collège. La beauté charnelle du paysage et la proximité de la mer ajoutaient encore leurs charmes au philtre d'amour.
« La volupté de sentir qu'on n'est pas seul et d'étreindre un autre soi-même, de donner une émotion heureuse en recevant une émotion heureuse me hantait de plus en plus. » Il devinait que d'autres, plus instruits, habiles ou hardis, réalisaient son rêve. Et c'est avec jalousie qu'il observait leurs manèges. « J'ai des heures de hardiesse et de timidité farouche. » Presque tous le trouvaient joli ; la plupart des grands et plusieurs petits désiraient de lui quelque chose qui était de la caresse mais aussi de l'inconnu. « Si un seul m'avait voulu, je crois que je lui aurais adressé d'encourageants sourires... mais ils étaient nombreux. »
Il devinait qu'un cercle de jalousies presque écloses entourait son avenir et il craignait, répondant « je veux vous faire à tous les plaisirs que vous voudrez » de ne s'attirer que méprisantes invectives.
Bientôt, sur les murs, sur les bancs, sur les tables, s'étalait son nom, accompagné de déclarations obscènes ou d'injures. « Je les haïssais, ces mots, parce qu'ils rendaient laide et grotesque la plus belle des choses et la plus profonde, la caresse. »
Il avait passé en revue tous ses camarades et avait choisi les plus beaux, trois petits de son âge, deux grands de quatorze à quinze ans, se promettant que l'un ou l'autre de ces cinq recevrait un jour ses caresses et les lui rendrait. Mais aucun de ceux-là ne paraissait le remarquer tandis que d'autres l'entouraient d'un amour virant peu à peu à la haine.
Que trouverait-il, s'il consentait au désir d'un de ses poursuivants ? Au terme de sa recherche, il n'aboutissait qu'à cette réponse : la paix perdue. Il attendrait les vacances et, ce jour-là, il serait l'ami d'un grand, d'un de ceux qui ne devaient plus revenir. Ainsi, après avoir connu la caresse inquiétante, il serait libre de la cultiver ou de s'en défendre.
Bientôt les inscriptions portèrent « M'amselle Françoise » ou « la fille manquée », vocable qui, exprimant sa grâce faible et ses cheveux bouclés, lui plut. Il ne se sentait plus le courage d'attendre ; mais se livrerait-il au premier venu ? Non, il choisirait. Tandis qu'il se reprochait cette fuite dilatoire, sa curiosité avide croissait.
Il va nous dire comment il fut « ami de toutes les manières » de Romanes, de Signoret, de Carminé, de Biradiou ou de Davignon.
A la rentrée d'octobre, les choses ne reprirent pas au point où elles avaient été laissées ; l'un était mort, un autre se refusait au baiser, piège du diable, car il se destinait au Séminaire. Ce fut Jean Provençal, le préféré, qui l'attirait et lui répugnait tout à la fois, avec ses douceurs célestes et ses infernales âpretés. A un autre, il griffonna : « Tout ce que tu voudras, toi et les autres. A partir d'aujourd'hui, la "fille manquée" est une putain heureuse de faire plaisir à quiconque aime le plaisir. Je serai d'abord à toi, puis viendront... Fais passer ce papier à tout le monde excepté à... que ceux qui aiment la "fille manquée" s'inscrivent ; chacun aura son tour. Quand ce sera fini on commencera une nouvelle liste. »
La liste revint à son point de départ couverte de signatures : tous les grands et beaucoup de petits s'étaient inscrits. A la récréation, plusieurs vinrent lui dire, timides, qu'ils n'avaient pas osé laisser voir leur nom à tout le monde mais qu'il fallait les y noter.
François usait de sa nouvelle puissance comme redresseur de torts, le désir et l'espoir faisant dociles ses camarades : de là, un nouveau surnom, « la reine Françoise ». « Moi, l'affamé d'amour, je me voyais aduler de tout un peuple ; moi, si avide de donner du bonheur, j'étais la joie de tous. Chaque jour je me grisais à cinq ou six griseries causées par moi. Quelques-uns sans doute me dégoûtèrent... Toutes passives, ces joies trop souvent renouvelées ébranlèrent ma faible santé. » De fait, les récréations et les promenades ne suffisaient plus ; il lui fallait prétexter un manque d'air, à l'étude du soir, pour gagner la cour, noyée d'obscurité, où certains allaient le rejoindre.
Un chahut monstre faillit déclencher, un jour, la foudre dévastatrice, mais le pion, trop compromis avec deux élèves, ne put qu'accepter le rôle de complice :
« Je ne vous demande que du travail et du silence ; je passerai sur bien des petites choses. »
Après une crise de volupté intense, François s'évanouit ; on le transporte à l'infirmerie où il restera vingt-trois jours. Lui absent, le troupeau va se diviser contre lui-même ; ce ne sont plus que rixes, querelles, rancunes, des couples qui se cachent, des solitaires qui persécutent les couples : son œuvre croulait.
Lorsqu'il reprit sa place à l'étude, le charme était rompu. « Les grands me regardaient avec mépris, les petits me haïssaient ou me redoutaient. Tous craignaient de me voir tomber, défaillant, mort peut-être pendant que je les caressais. »
C'est avec Jean Provençal – brutal et affolant – qu'ivre de convalescence et ivre du printemps il va renouer :
— Je serai ton amant et ton maître ; j'ai envie de toi mais je te hais, putain que tu es fière d'être.
Les injures et les coups ne font qu'affoler sa joie : « Oui, tout est bon de toi. »
Mais la Roche Tarpéienne est proche du Capitole. Le pion, abusant de son triomphe, amassait la haine dans les cœurs. Une conjuration fut ourdie et ses relations suspectes rapportées au directeur qui le renvoya avec un peu d'argent et le conseil de fuir en Italie.
La Justice, à l'oreille fine, s'empara de l'affaire et le scandale fut énorme. L'établissement fut sur le point d'être fermé ; les élèves partaient les uns après les autres. « L'oncle Bertrand m'enleva du milieu empesté. Le pauvre enfant – pensait-il – il est si naïf, il n'a rien dû voir, rien comprendre ; mais à la longue, tout de même, qui sait ? »
Ce départ, pour François, sonna le glas d'une expérience. Une autre allait être tentée pour répondre aux exigences de sa nature. Il revint vers sa cousine Lisa. Comment avait-il pu se tromper si longtemps sur ses sentiments véritables ? Dissipé, l'horrible malentendu. Ils partent ensemble en voyage, se cherchant tous deux : lui, prodigue des câlineries un peu puériles ; elle, vibre, impatiente d'une réalité plus substantielle. « J'ai aimé Lisa comme pourrait l'aimer une femme... Elle a accepté mes caresses..., elle a goûté mon adresse délicate. Mais, après, elle m'a repoussé avec dégoût et aujourd'hui elle boude. »
Hélas ! la « fille manquée » n'est pas un homme elle va bientôt se retrouver seule devant une lettre d'adieu.
Le souvenir de Provençal resurgit avec violence « Seul maître de mon âme, de ma chair, de mon passé, de mon présent, de mes regrets et de mes irrépressibles rêves d'avenir. » Pour l'exorciser, il se voue aux femmes du Quartier Latin ; mais, à leurs yeux, il n'est que « le miché qui ne fait jamais l'amour » et, si lasses qu'elles soient de la brutalité des mâles, il ne parvient même pas à s'en attacher une !
« Je suis incapable de conserver une femme. Tari par le moindre effort, je ne puis satisfaire celles-là même qui demandent le moins à l'homme et à ses énergies... Tous les corps féminins dégoûtent ma vue ou ma mémoire. Quelle collection de laideurs une femme ordinaires !... Mes nostalgies appellent des corps d'adolescents. »
Au Louvre, c'est devant les Apollons, les Antinoüs que s'arrêtent ses méditations inépuisables et devant les sveltesses enlacées de certains groupes de lutteurs. Les androgynes du Vinci, il les aime comme des portraits de ce qu'il peut donner, non comme des portraits de ce qu'il voudrait posséder.
Il cherche refuge dans les insatisfactions solitaires, il lit, il voyage. Mais ces moyens, de même que les déguisements et les bijoux dont il se pare, ne sauraient tromper les avidités de sa nature féminine. « La vraie joie me paraissait toujours consister à faire tressaillir de volupté un beau corps de mâle. »
Et voici, à la date du 26 juin 1901 à 8 heures du soir, la dernière page de son cahier intime :
« J'ai soif de mourir..., je vais dépouiller mon corps. Suis-je bien coupable de l'avoir souillé ? Mon âme passionnée avait besoin d'un corps puissant ; ma faiblesse m'a condamné à l'ignominie. Où serai-je dans quelques minutes ? Et que serai-je ? Oh ! pourvu que je ne sois pas encore un être manqué, un être qui n'a pas les organes de ses instincts ! S'il y a Quelqu'un qui dirige les destinées, osera-t-il me punir du crime qu'il a commis envers moi ? Vous êtes témoin, Seigneur, que j'étais par votre volonté une maison aveugle... La lumière du soleil ne pouvait pénétrer ici. J'ai remplacé par la clarté des lampes, la caresse absente du ciel. Mais seul le jour naturel est une inondation de bonheur. Les lumières artificielles – ah ! comme cruellement vous me l'avez appris – font, autour d'un petit cercle de joie vacillante, un grand cercle de pénombre et de tristesse. Mais je vous le demande – parce que peut-être vous êtes juste — qui est responsable des tentatives où je me suis blessé ? N'est-ce pas Celui qui m'avait exilé des voluptés normales, qui m'avait refusé également les triomphes vigoureux de l'homme et les défaites pâmées de la femme ? Pauvre maison aveugle que j'appelle mon corps, voici que tu vas tomber, démolie. Rendras-tu à une vie plus harmonieuse et à une demeure moins sombre le misérable prisonnier qui languit vingt-six ans dans tes ténèbres ?... »
François de Taulane s'est tué dans la nuit du 26 au 27 juin. Son valet de chambre entendit un coup de revolver. Il accourut. Au moment où il ouvrait la porte, un second coup retentit. Il trouva son maître, tout baigné de sang, les yeux ouverts encore sur l'étrangeté de la vie et frissonnant de son dernier frisson.
Arcadie n°101, Robert Amar (René-Louis Dubly), mai 1962
La fille manquée de Han Ryner, réédition chez GKC, 184 pages, 2013, ISBN : 9782908050844, 17€

/image%2F1477403%2F20150214%2Fob_a07756_banniere-blog-nouvelle-version-2015.jpg)


/idata%2F0051799%2Flogo%2FARCADIE-LOGO.jpg)
/image%2F1477403%2F20180209%2Fob_4b3279_andre-baudry-deces-2018.jpg)