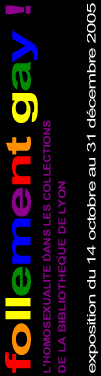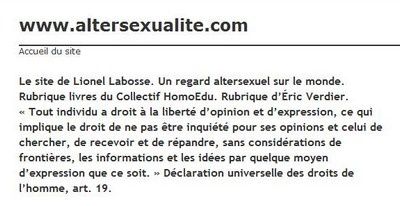Entre les lignes : Du côté de chez Anatole France par Jacques Fréville
 Chers cousins d'Arcadie,
Chers cousins d'Arcadie,
La brillante traduction – si pleine de suc et riche des parfums de ce siècle que Balzac, justement, a baptisé, par opposition au « Grand », le « Bon siècle » – qu'a donnée, en ces colonnes, l'aimable plume, et fraternelle, de Marc Daniel, pour Fanny Hill, m'incite, en cette après-midi de Pentecôte soleilleuse, à vous parler une fois encore de mon bon maître : le père France.
Je dis « une fois encore », car ceux de vous qui me font, soit désœuvrement ou charité, l'amitié de bien vouloir me lire, se rappellent sans doute que j'ai déjà, il y a quelques années, évoqué en Arcadie le débonnaire auteur des Coignard et des Bergeret. C'était de l'homme que je parlais pour lors, et de sa bienveillante humanité à notre endroit. Aujourd'hui, simplement, mon propos sera, si vous me le permettez, de rapporter une page d'un de ses romans (et non des moindres) où, soit distraction ou fantaisie, il s'est oublié jusqu'à évoquer, à sa façon cursive, les tentations d'en face. La chose est rare ; et, comme vous allez le voir, elle fait penser au texte dont je vous disais un mot à l'instant : celui de Fanny Hill, dans sa version Daniel.
Quand les dieux avaient soif
« Les dieux ont soif » (1912), nul de vous, je l'espère, n'en ignore, c'est un roman où l'auteur du « Petit Pierre » s'attache à peindre un tableau de violences et d'insanités, répugnant à ses goûts intimes, celui de la Révolution. Je veux dire : la grande, la vraie, l'unique, celle qui, partie des événements qui libérèrent sept fous en un jour de juillet, se termina sur ceux qui, en un jour de brumaire, libérèrent un autre fou, un seul... mais quel fou !
Or, le chapitre XXIe de l'ouvrage commence par un récit qui, cousins, nous concerne.
Julie Gamelin y rend visite, incognito, en tapinois, à son amant embastillé au Luxembourg (tant il est vrai que seules changent les bastilles) ; pour ce faire, elle se travestit en jeune premier appétissant. Laissons parler le papa France :
« Cependant, Julie Gamelin, vêtue de son carrick vert bouteille, allait tous les jours dans le jardin du Luxembourg, et là, sur un banc, au bout d'une allée, attendait le moment où son amant paraîtrait à une des lucarnes du palais. Ils se faisaient des signes et échangeaient leurs pensées dans un langage muet qu'ils avaient imaginé. Elle savait par ce moyen que le prisonnier occupait une assez bonne chambre, jouissait d'une agréable compagnie, avait besoin d'une couverture et d'une bouillotte, et aimait tendrement sa maîtresse.
Elle n'était pas seule à épier un visage aimé dans ce palais changé en prison. Une jeune mère près d'elle tenait ses regards attachés sur une fenêtre close et, dès qu'elle voyait la fenêtre s'ouvrir, elle élevait son petit enfant dans ses bras au-dessus de sa tête. Une vieille dame, voilée de dentelle, se tenait, de longues heures, immobile sur un pliant, espérant en vain apercevoir un moment son fils qui, pour ne pas s'attendrir, jouait au palet dans la cour de la prison, jusqu'à ce qu'on eût fermé le jardin.
Durant ces longues stations sous le ciel gris ou bleu, un homme d'un âge mûr, assez gros, très propre, se tenait sur un banc voisin, jouant avec sa tabatière et ses breloques, et dépliant un journal qu'il ne lisait jamais. Il était vêtu à la vieille mode bourgeoise, d'un tricorne à galon d'or, d'un habit zinzolin et d'un gilet bleu, brodé d'argent. Il avait l'air honnête ; il était musicien, à en juger par la flûte dont un bout dépassait sa poche. Pas un moment il ne quittait des yeux le faux jeune garçon, il ne cessait de lui sourire et, le voyant se lever, il se levait lui-même et le suivait de loin. Julie, dans sa misère et dans sa solitude, se sentait touchée de la sympathie discrète que lui montrait ce bon homme.
Un jour, comme elle sortait du jardin, la pluie commençant à tomber, le bon homme s'approcha d'elle et, ouvrant son vaste parapluie rouge, lui demanda la permission de l'en abriter. Elle lui répondit doucement, de sa voix claire, qu'elle y consentait. Mais, au son de cette voix, et averti, peut-être, par une subtile odeur de femme, il s'éloigna vivement, laissant exposée à la pluie d'orage la jeune femme, qui comprit, et malgré ses soucis, ne put s'empêcher de sourire. »
Nul de vous, cousins, j'en suis sûr, n'approuvera le monsieur à l'habit zinzolin et au trop exclusif parapluie rouge : la galanterie est chose très arcadienne. Et nous tous, Arcadiens à part entière, ou Béotiens à demi-part, savons trop que, faute d'accorder toujours ce qu'on appelait jadis « la courtoisie » aux dames, nous nous devons de leur concéder les rudiments d'une civilité « puérile et honnête ». Si ceci, certes, ne passe point cela, donner ceci peut à tout le moins excuser de ne donner point cela.
N'empêche, au reste, que ce qui, dans ce court texte – le seul à ma connaissance, où France ait abordé (disons plus simplement : effleuré) nos tristes problèmes –, s'achève par un mot qui est, à lui seul, tout une leçon de sagesse : le mot « sourire ».
Être payé par un sourire, cousins, même nacré d'ironie, même zébré d'un furtif dédain, n'est-ce pas être payé, tout bien pesé, d'un peu d'humaine compréhension ?
Puissent donc, décidément, les leçons du père France être entendues au siècle de Bardot !...
Telle est la grâce qu'en vous quittant vous souhaite, et se souhaite à lui-même,
Votre cousin de Béotie,
Jacques Fréville
Arcadie n°155, Jacques Fréville, novembre 1966

/image%2F1477403%2F20150214%2Fob_a07756_banniere-blog-nouvelle-version-2015.jpg)


/idata%2F0051799%2Flogo%2FARCADIE-LOGO.jpg)
/image%2F1477403%2F20180209%2Fob_4b3279_andre-baudry-deces-2018.jpg)