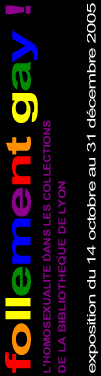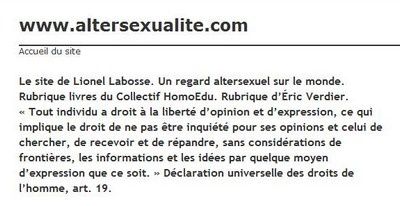Retour à l'original par G. Veher (à propos de l'adaptation de « La chatte sur un toit brûlant » de Tennessee Williams)
 Pour pouvoir être représentée chez nous, La chatte sur un toit brûlant, la dernière pièce de Tennessee Williams a payé un lourd tribut à ce que notre ami Marc Daniel appelait récemment le néo-puritanisme français.
Pour pouvoir être représentée chez nous, La chatte sur un toit brûlant, la dernière pièce de Tennessee Williams a payé un lourd tribut à ce que notre ami Marc Daniel appelait récemment le néo-puritanisme français.
Il y a, dans le texte américain de la pièce, aussi bien dans ses dialogues que dans les notes dont l'auteur accompagne l'édition originale de Secker and Warburg, London, et qui en éclairent à la lecture le sens profond, une intonation et une franchise que l'adaptation française est loin d'avoir rendues honnêtement.
Qu'une amitié d'hommes soit possible, cette pièce entière nous le prouve. Comme elle montre aussi que certaine amitié passionnée, c'est celle-là même dont une vaine majorité désigne ses partenaires sous les qualificatifs de... Fairies, old sisters, sissy ducks..., ces mots que M. André Obey n'a pas pu traduire – alors que l'intention de T. Williams était justement d'exprimer par eux l'opinion vulgaire et de la rapprocher de sa propre erreur par le spectacle de la souffrance qu'elle occasionne chez des êtres aussi sensibles que Brick.
Mais ce qui est plus grave peut-être, c'est que l'adaptation française ne vise pas seulement les « excès » de langage de M. T. Williams ou la verdeur de son verbe, mais qu'elle touche à la détermination même du personnage central. Des trois personnes qui jouent, en effet, un rôle décisif dans la vie de Brick : Big Daddy, Maggie la Chatte et M. André Obey, l'adaptateur parisien, celui-ci n'est pas le moins pressé d'imposer à ce héros difficile une demi-vérité confortable.
A vrai dire, cette pièce partait déjà d'une hypothèse délicate :
Peut-on montrer à la rampe d'un théâtre un homme qui prendrait peu à peu conscience de sa nature homophile et se l'avouerait à lui-même ?
Peut-on concevoir, à moins qu'il ne meure, comme dans « Sud – auquel cas tout serait tellement plus simple – que la pièce puisse se conclure et le rideau se baisser alors que notre héros aurait jusqu'au bout refusé l'amour de la femme ? Cela est bien difficile, surtout à Paris.
Dans l'édition originale à laquelle, nous nous référons, T. Williams a présenté tout d'abord la première version qu'il avait écrite du troisième acte de sa pièce. Il nous explique que c'est sur la demande d'Elia Kazan, son producteur, qu'il avait accepté de refaire cet acte, afin d'y adoucir quelque peu l'atmosphère de tension intolérable qui règne entre ses personnages par le pressentiment d'une réconciliation prochaine et peut-être du triomphe de Maggie la Chatte... Cette évolution de Brick, cette lente mutation se serait faite en lui après la scène de confession avec son père Big Daddy, au deuxième acte. M. T. Williams, qui semble avoir cependant une certaine préférence pour le troisième acte tel qu'il l'avait tout d'abord conçu, et qui renvoie le lecteur à la comparaison des deux versions pour qu'il se fasse une idée lui-même, ajoute :
« La paralysie morale de Brick était une chose centrale dans sa tragédie, et montrer une progression dramatique de son caractère rendrait plus obscur le sens profond de sa tragédie intérieure. Car je ne crois pas qu'une conversation, aussi révélatrice soit-elle, puisse produire un tel changement dans le cœur ou le comportement d'un être arrivé à un degré de désespoir comme celui de Brick. »
Aussi bien, même dans la version donnée au Théâtre de Broadway, cette évolution de Brick vers Maggie n'est-elle pas précipitée de façon aussi nette que dans l'adaptation française. Son comportement garde un caractère de refus profond.
A la fin du troisième acte (version originale), c'est Brick qui répond à Maggie :
« Je ne dis rien, je pense qu'il n'y a rien à dire. »
Et lorsque Maggie lui dit à nouveau qu'elle l'aime, il lui répond par cette même parole amère déjà entendue de la bouche de Big Daddy, ce patriarche sensuel et misogyne lorsqu'il s'adressait à sa femme :
« Comme ce serait delle si c'était vrai. »
Par contre, dans le troisième acte de la version de Broadway, d'où est tirée en grande partie l'adaptation française, c'est Maggie qui parle la dernière à la fin de l'acte. C'est elle qui caresse le visage de Brick alors que le rideau tombe. Brick reste immobile et ne répond pas.
Il en est tout autrement au Théâtre Antoine, à Paris, où une telle pièce ne pouvait décemment se terminer que par un triomphe sans équivoque de la femme. Lorsque Maggie lui dit : « Je t'aime », Brick lui répond : « Je commence à le croire » et tend le bras vers elle. Passons.
M. André Obey a dû méditer cette pensée de François Mauriac à propos de « Sud » : « C'est le propre d'une grande œuvre que ses personnages nous escortent longtemps après la représentation, comme si chacun d'eux avait encore quelque chose à nous dire...
Après cet aperçu des limites générales dans lesquelles nos « censeurs » ont bien voulu admettre la représentation de cette pièce, il est intéressant de noter les nombreux points sur lesquels l'adaptation française reste encore en-deçà de l'expression originale, ou escamote même le plus souvent sa portée.
Certains critiques ont reproché à cette pièce la crudité de ses mots, sa « chiennerie », la sensualité épaisse et débordante dans laquelle elle baigne.
Et pourtant Brick est le héros d'un drame sombre dont la violence tragique et la grandeur rappellent parfois celle d'un drame antique. Faut-il rappeler à nos critiques si distingués qu'on trouverait aisément dans Eschyle des lueurs fulgurantes sur le rapport des sexes et des phrases telles que celles-ci dont on n'ose plus aujourd'hui penser sans frémir qu'elles pourraient être « adaptées » :
« Va, ce n'est point l'amour, c'est le mâle qu'elle flaire en toi comme une chienne et pour toi elle est cette femelle que tu vas inonder de ton désir. » (1).
Mais dans notre monde moderne, après vingt siècles de pseudo-humanisme gréco-latin, Brick est devenu cette victime de l'univers bostonien, cet être infirme, traqué, jeté à terre, une épave. Beaucoup plus qu'un portrait psychologique, il est ici la figure allégorique du drame.
C'est par ceux qui l'entourent que Brick s'éveillera à la conscience de lui-même.
C'est Maggie la chatte tout d'abord qui, de son toit brûlant, lui rappelle dans sa complainte que ce qu'elle aimait le plus en lui c'était la façon qu'il avait de faire l'amour :
« Tu étais merveilleux au lit, lui dit-elle; tu faisais cela aussi simplement que si tu avais eu à ouvrir une porte devant une dame ou à la faire asseoir à une table. Ton indifférence te rendrait merveilleux dans l'acte d'amour. C'est étrange, n'est-ce pas ?... »
Mais le souvenir de Skipper est encore entre eux. Elle sait que ce souvenir empêche Brick de la rejoindre. Pour mieux le vaincre et le détruire, elle évoque à nouveau cette amitié.
Elle lui dit :
« Il était si pur cet amour qu'il a tué, le pauvre Skipper. Tous les deux, vous aviez en commun je ne sais quoi qui doit être gardé dans de la glace comme une chose incorruptible et ta mort seule pouvait le garder...
« ... C'était une de ces choses belles et idéales comme on les voit parfois dans les légendes grecques, ce ne pouvait être rien d'autre avec toi, et c'est pourquoi cela rend la chose si triste, c'est ce qui la fait si terrible, car c'était un amour qui n'aurait jamais pu être accompli ou dont il n'attrait pas été possible de parler simplement.
« Brick, je te le dis et tu dois le croire; je comprends tout cela, Brick, c'est une chose noble. Ne peux-tu croire à ma sincérité lorsque je te dis que je la respecte ? La seule idée que j'en ai, c'est que la vie doit continuer même après que le rêve de la vie est passé. »
Mais la confidence se fait plus précise et la jalousie plus douloureuse :
« Cette fois-ci, je vais aller jusqu'au bout de ce que j'ai à te dire. Skipper et moi nous avons fait l'amour – si on peut appeler cela l'amour –, car cela a fait que nous nous sommes sentis tous deux un peu plus près de toi. »
« Et ainsi, nous avons couché ensemble en rêvant chacun de notre côté être avec toi. »
C'est Maggie aussi qui a dit à Skipper :
« Skipper, il faut cesser d'aimer mon mari ou bien alors tâche qu'il se laisse convaincre qu'un tel amour est possible ! »
« Ainsi je l'ai détruit en lui disant cette vérité que ni lui ni le monde dans lequel il était né et avait été élevé, que ton monde et le sien ne pourraient avouer ces choses
« Mais Brick ? Skipper est mort et je vis.
« Maggie la chatte est —
« Vivante ! Je vis ! »
On n'est pas près d'oublier ce deuxième acte de La Chatte sur un toit brûlant, la nuit chaude et humide de la plantation, et cette scène extraordinaire entre le père et le fils qui est sans aucun doute possible un des sommets du théâtre moderne.
Big Daddy a beaucoup vécu. Il a connu les misères et les laideurs de la société. Il sait l'injustice de l'homme à l'égard de l'homme. Toutes les images du monde sont en lui. Il se souvient de l'Europe, de ces enfants décharnés qu'il a vu errer comme des chiens sur les collines de Barcelone, à côté de prêtres bien nourris et plaisants. Il connaît l'humanité sous tous ses jours. Partout, il a trouvé le mensonge et la peur. Il a vu des prostitutions de femmes aidées dans leur racolage par leurs fillettes de cinq ans. Il sait que la communication entre les êtres est une chose difficile, que chacun porte seul son destin sur cette planète étrange et que dans la boucherie de l'existence le sort de l'homme est plus pitoyable que celui du porc, car il a sur lui le privilège de la connaissance, la certitude de l'égorgement final.
A Brick qui lui dit :
« Crois-tu donc que Skipper et moi étions...
Il répond :
Fils, j'ai roulé ma bosse dans le monde... »
Il lui rappelle ce qu'il doit pour sa part à Jack Straw et Peter Ochello, les anciens propriétaires de cette plantation de coton dont il est aujourd'hui le maître, et qui l'avaient accueilli alors qu'il ne possédait rien. Lorsque Brick lui demande :
« Me prends-tu donc, Skipper et moi, pour Straw et Ochello, cette paire de vieilles tantes qui couchaient là, dans ce lit, où ils sont morts tous les deux ? »
Big Daddy lui répond, avec sérénité, à deux reprises, dans la version de Broadway :
« Ne leur jette pas la pierre. »
Tennessee Williams, dans sa note pour la mise en scène, a écrit :
« Le style de la chambre où se joue cette scène n'a pas beaucoup changé depuis le temps où elle était occupée par les premiers propriétaires de la plantation, Jack Straw et Peter Ochello, une paire de vieux célibataires qui la partagèrent leur vie durant. En d'autres termes, cette chambre doit évoquer le fantôme de l'amitié de ces deux hommes qui a dû atteindre à un degré de tendresse peu commune. »
Lorsque Brick toujours troublé emploie le mot de « Pairies l'auteur ajoute, dans une note marginale :
« Nous découvrons, dans la façon qu'il a de prononcer ce mot, la marque profonde de ce conformisme social dans lequel il a été élevé et dont il a subi très tôt l'influence. »
Devant une nouvelle charge de Brick contre cette paire de « vieilles tantes », Big Daddy garde une attitude impassible et, selon la note explicative de Tennessee Williams, il sépare à ce moment même « le grain de la balle ».
C'est Big Daddy enfin qui fera comprendre à Brick qu'il est lui-même l'auteur de son propre malheur :
Cette angoisse de Brick, n'est-ce pas le dégoût qu'il a de lui-même, le remords qui est le sien de n'avoir pas répondu à Skipper lorsque celui-ci a osé au téléphone lui avouer son amour ?
Brick a raccroché le récepteur. Il ne devait plus jamais entendre la voix de Skipper.
« Ce dégoût du mensonge, c'est le dégoût de toi-même, dit Big Daddy. Tu as creusé la tombe de ton ami et tu l'y as jeté au lieu de faire face à la vérité avec lui. »
N'est-ce pas le regret de l'amitié perdue qui, même encore à la fin de la pièce, hantera toujours l'âme de Brick, alors qu'il va peut-être accepter de reprendre le jeu des apparences et du conformisme ?
« Je n'ai jamais menti à personne, à personne, sauf à moi. C'est à moi-même que j'ai menti... »
Il y a plus, dans la pièce de Tennessee Williams, que le renouvellement qu'elle apporte aux thèmes habituellement traités sous l'éclairage du théâtre.
Et la scène de l'acte II n'exprimerait-elle pas aussi encore, à travers l'humanité douloureuse de Big Daddy et par-delà le cercle des interdits qui n'est que celui des mensonges, cette nécessité essentielle à laquelle Brick s'est dérobé : le consentement à l'amour physique : « Pour qu'une amitié soit durable, a dit un poète, il faut que quelque chose s'y passe... »
Il est dommage que l'adaptation qui a été faite de cette pièce n'ait pas cru pouvoir lui laisser cette vérité entière qui a été la sienne à New-York, sur le plateau du Théâtre de Broadway.
Il est désolant que des répliques telles que celles-ci aient été coupées :
« Quand Jack Straw est mort, le vieux Peter Ochello s'est laissé dépérir tout comme un chien à la mort de son maître et il est mort lui aussi... Je comprends ces choses-là... ».
Et à Brick encore qui s'indigne à nouveau et rappelle l'exemple de ce jeune garçon accusé d'une tentative de sodomie, qui a été chassé du collège et obligé d'aller se cacher loin de la société, quelque part en Afrique, Big Daddy répond :
« Je reviens de plus loin que cela, je reviens de l'autre face de la lune, du pays de la mort, fils, et je ne suis pas prêt à m'émouvoir pour un rien. Toujours, d'ailleurs, j'ai vécu avec trop d'espace autour de moi pour être infecté par l'opinion des autres. Il y a une chose à laquelle tu peux accorder plus d'importance qu'au coton, c'est la tolérance ! »
La tolérance, un mot que nos spectateurs parisiens auront eu la possibilité d'entendre, un mot qui n'a pas échappé à l'adaptation française (2).
(1) Dans l'Orestie. 458 avant J.-C. Voir : Théâtre et possession au temps d'Eschyle, par Jacques Lacarrière.
(2) Ne semble-t-il pas à voir l'acharnement de certaines critiques contre cette pièce (celle de M. Jean-Jacques Gauthier du Figaro par exemple) que La chatte sur un toit brûlant, ait quelque peu pâti de la crise de Suez et des difficultés franco-américaines ?
C'est là, nous le savons, un trait assez fréquent du tempérament français, qu'il sépare assez difficilement l'appréciation esthétique de l'émotion politique de l'instant. Et c'est ainsi que certains, parmi les plus grands, des chefs d'œuvre étrangers de la musique ou du théâtre, passèrent un jour, inaperçus, par Paris.
Par contre, nous sommes heureux de rappeler pour finir que M. André Obey fut un des premiers à fonder L'Union des écrivains pour la Vérité, en réplique aux pitoyables et scandaleuses décisions de Dame Censure, qui avait tenu à célébrer à sa façon le centenaire des Fleurs du Mal et de Madame Bovary ! Toute la presse intelligente du reste avait été secouée d'indignation.
Arcadie n°39, G. Veher (pseudonyme de l'écrivain Gérald Hervé - 1928/1998), mars 1957
Ce texte a été réédité en 2004 (Soignies : Talus d'approche) avec la pièce de théâtre "Florence ou la ville aimée deux fois" (1959) puis en 2017 (Chauray : La Ligne d'ombre), édition augmentée d'une autre pièce dramatique du même auteur, "L'Harmonica".

/image%2F1477403%2F20150214%2Fob_a07756_banniere-blog-nouvelle-version-2015.jpg)


/idata%2F0051799%2Flogo%2FARCADIE-LOGO.jpg)
/image%2F1477403%2F20180209%2Fob_4b3279_andre-baudry-deces-2018.jpg)