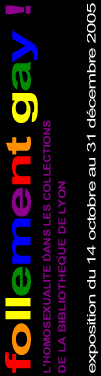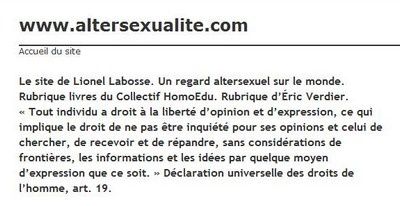L'enfant, un alibi pour ne pas vivre
 Jusqu'au XVIIe siècle, l'enfant a compté pour du beurre. Il semble avoir ensuite gagné une place de rêve. Mais en réalité, que fait-on de lui dans la société consommatrice, où le mythe du héros moderne, robotisé, battant et violent est survalorisé ? Au monde de l'enfance rien ne semble épargné.
Jusqu'au XVIIe siècle, l'enfant a compté pour du beurre. Il semble avoir ensuite gagné une place de rêve. Mais en réalité, que fait-on de lui dans la société consommatrice, où le mythe du héros moderne, robotisé, battant et violent est survalorisé ? Au monde de l'enfance rien ne semble épargné.
Obscurément à l'œuvre à travers divers procédés d'éducation, on retrouve cette idée, mise en lumière par Nietzsche dans « La naissance de la tragédie », selon laquelle la vie est quelque chose qui doit être rectifié, corrigé, réprimé en quelque sorte par l'éducation.
Et si, au fond de toute manœuvre pédagogique pavée de bonnes intentions, était tapie une haine farouche, indéfectible, de la vie ? Et si, en définitive, à travers les mille nuances qu'elle peut revêtir à travers l'espace et le temps, l'éducation perpétuait l'organisation, plus ou moins rationnelle, d'un vaste massacre ?
Le roi Hérode, peut-on lire dans le Nouveau Testament, ayant appris par ses devins la naissance, dans son royaume, d'un enfant d'essence très haute, appelé à une royauté supérieure à la sienne, décida de procéder sur le champ au fameux « Massacre des Innocents ». On sait comment, mystérieusement prévenus par un télex céleste, Joseph, Marie quittèrent rapidement le pays pour aller chercher refuge en Egypte.
Il est permis de rapprocher cet épisode des Evangiles de la légende grecque relative à Cronos, père et fils indignes s'il en fut. Fils d'Ouranos, dieu du ciel, Cronos met fin à la première génération des dieux en tranchant les testicules de son propre père. Afin de ne pas être détrôné à son tour par sa progéniture, suivant les prédictions de ses parents, il dévore ses propres enfants dès la naissance, jusqu'à ce que Zeus, un jour, avec la complicité de sa maman, décide de mettre un terme à ce cannibalisme familial en tuant son père, qui d'ailleurs ressuscitera.
A travers ces deux fables, une vérité métahistorique semble se faire jour : il se pourrait qu'elle n'ait rien perdu de sa terrible actualité.
Toutes les sociétés, à l'image de l'insatiable Cronos qui refuse de toutes ses forces de voir mis en question son vieux règne, et qui est prêt pour cela à tous les sacrifices, ne donnent-elles pas à voir une consommation effrénée de l'enfance ?
Consommation, bien sûr, présentée sous des formes plus ou moins insidieuses, puisque en définitive c'est toujours « pour son bien » que l'enfant est mis à mort.
Un tel massacre se justifie-t-il ? Cela vaut-il vraiment le coup ? Quand on jette un regard sur le déroulement de l'histoire humaine telle qu'elle s'écrit en lettres de sang et de feu, avec son cortège de viols, d'intolérances, de boucheries héroïques, on est en droit de se demander si la civilisation adulte et responsable mérite approbation et admiration. Sans doute est-on en droit d'émettre un sacré doute sur la valeur des différentes sauces éducatives avec lesquelles ont été accommodés, jusqu'ici, les petits des hommes.
Environ jusqu'au XVIIe siècle, comme l'a mis en évidence Philippe Ariès dans sa magistrale « Vie de l'enfant sous l'Ancien Régime », celui-ci a un statut insignifiant, gênant dans le meilleur des cas, au pire source d'une véritable terreur : Bossuet n'écrit-il pas que « l'enfance est la vie d'une bête » ? Pierre de Bérulle, dans son « Opuscule de piété », que « l'état enfantin est l'état le plus vil et le plus abject de la nature humaine, après la mort » ?
Une telle hostilité laisse rêveur, ainsi que le traitement qui est réservé à l'enfant jusqu'au XVIIe siècle : manque total d'hygiène, mortalité effarante, mise en nourrice systématique ou exposition pure et simple sur la voie publique.
Le sentiment de l'enfance n'apparaît véritablement qu'au XIXe siècle, en même temps que la famille bourgeoise nucléaire, issue du capitalisme montant, fait son entrée dans l'arène de l'Histoire. Certes, la condition enfantine connaît à cette époque une amélioration que personne ne songerait à contester. Mais il est permis de se demander à quel prix.
Sans doute grâce à l'impulsion d'un J.-J. Rousseau au XVIIIe siècle, l'enfant acquiert-il une valeur et un statut particuliers : il jouit désormais du capital de tendresse de sa mère qui, comme le met en évidence Elisabeth Badinter dans « L'amour en plus » « se dépouille de ses aspirations de femme pour se consacrer désormais à ce roi de la famille ». Un tel sacrifice donne évidemment à rêver et suscite encore largement aujourd'hui l'attendrissement des foules.
Cependant, cette abnégation lumineuse n'est pas sans comporter son revers d'ombre : tendre objet de tous les soins et de tous les sacrifices parentaux, l'enfant paie en réalité très cher ce régime de faveur. Souvent, il n'aura pas assez de toute sa vie pour s'acquitter d'une pareille dette.
Il se trouve investi ainsi de toutes les attentes parentales, sommé de répondre à toutes les exigences (conscientes ou inconscientes) qu'on fera peser sur son jeune destin. Bref, un cadeau, un peu lourd à porter.
La grande majorité des parents ne font-ils pas des enfants dans le dessein de se survivre à travers eux ; de satisfaire leurs ambitions déçues ou inavouées. C'est avec le sang d'une progéniture que se cimentent les échecs d'une existence, que prend son sens le naufrage d'une vie à la dérive.
Aujourd'hui, sous des formes différentes, le festin de Cronos se poursuit, avec l'approbation des psychologues et des pédiatres, des pédagogues et des psychanalystes. La société de consommation invite à consommer de l'enfant, à puiser dans sa jeune vie la force d'alimenter un destin de mort qui n'a de sens que par et pour l'enfant. Car ce que l'enfant apporte en premier lieu aux individus qui se trouvent être ses parents, c'est un statut ontologique, une justification. A des personnes qui manquent fondamentalement d'être, l'enfant fournit une carte d'identité, sinon de crédit : celle du père et de la mère qui ont fait leur devoir – d'autant plus assurés de leur honorabilité qu'ils sont dans le droit fil de la « nature humaine », ce grand totem normatif.
Requis d'adhérer à ce scénario familial, l'enfant devient sans s'en rendre compte un otage de l'être de ses parents. En endossant ce costume cousu sur mesure, il sauve ses parents de la conscience de leur néant, leur fournissant un alibi d'autant plus précieux que ces derniers, la plupart du temps, ont résigné depuis longtemps toute ambition de vivre.

/image%2F1477403%2F20150214%2Fob_a07756_banniere-blog-nouvelle-version-2015.jpg)


/idata%2F0051799%2Flogo%2Fce-qui-fait-debat.jpg)
/idata%2F0051799%2Flogo%2Fphilosophes.jpg)