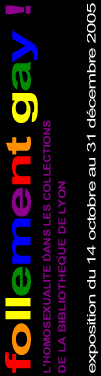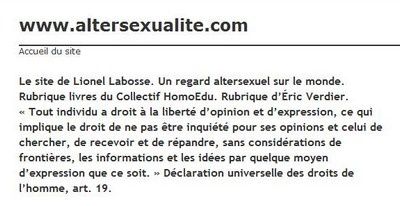La débâcle, Emile Zola (1892)
 Dans le roman « La Débâcle » qui fait partie du cycle des Rougon-Macquart, l'attention est attirée par une amitié, sinon particulière, au moins d'un caractère particulier, et traitée à fond, au milieu du cataclysme de 1870 : la guerre, la chute de l'Empire, l'invasion, la guerre fratricide, la Commune.
Dans le roman « La Débâcle » qui fait partie du cycle des Rougon-Macquart, l'attention est attirée par une amitié, sinon particulière, au moins d'un caractère particulier, et traitée à fond, au milieu du cataclysme de 1870 : la guerre, la chute de l'Empire, l'invasion, la guerre fratricide, la Commune.
Maurice Levasseur, reçu avocat au dernier automne, engagé volontaire, éprouve envers Jean Macquart, caporal, une répugnance, une sourde révolte contre cet illettré, ce rustre qui le commandait. Mais voici que les allées et venues inutiles du 106e d'un bout à l'autre de la France arrivent à faire une plaie au pied de Maurice.
Jean, paysan de bon sens, toujours bon avec les hommes de son escouade, et homme utile, lui donne des conseils. Un soir, après une nouvelle marche, Maurice veut enlever son soulier : il arrache la peau. Le sang jaillit, il eut un cri de douleur. Et, comme Jean se trouvait là, il parut pris d'une grande pitié inquiète.
— Dites donc, ça devient grave, vous allez rester sur le flanc... Faut soigner ça...
Et il avait des gestes maternels, toute une douceur d'homme expérimenté, dont les gros doigts savent être délicats à l'occasion. Un attendrissement invincible envahissait Maurice, ses yeux se troublaient, le tutoiement monta de son cœur à ses lèvres...
— Tu es un brave homme, toi...
— Merci, mon vieux.
Et Jean, l'air très heureux, le tutoya aussi, avec son tranquille sourire.
— Maintenant mon petit, j'ai encore du tabac, veux-tu une cigarette ?
Le lendemain, Maurice ne sentait plus son pied, mais plus tard il le retrouvait, lourd comme du plomb. Jean lui conseille de demander au major la permission de se faire conduire par une carriole au Chêne, où son régiment se rendrait. La permission obtenue, lorsque Jean aida Maurice à se hisser dans la carriole, ce dernier se retourna pour le remercier ; et les deux hommes tombèrent aux bras l'un de l'autre, comme s'ils n'avaient jamais dû se revoir... Maurice resta surpris de la grande tendresse qui l'attachait déjà à ce garçon. Et, deux fois encore, il se retourna, pour dire au revoir de la main.
Ainsi des liens forts d'une amitié profonde ont vite fait s'unir ces deux hommes.
Quelques jours plus tard, Maurice revient au régiment. Les provisions manquent. Lorsque Jean entendit Maurice se plaindre de n'avoir pas de pain, il se leva, disparut un instant, revint après avoir fouillé dans son sac. Et, en lui glissant un biscuit :
— Tiens, cache ça, je n'en ai pas pour tout le monde.
— Mais toi ? demanda le jeune homme, très touché.
Jean s'attendrit à la souffrance de Maurice. Il regardait d'un œil inquiet, en se demandant comment ce garçon frêle ferait pour aller jusqu'au bout.
Les ordres contradictoires et les marches pénibles n'ont pas de fin. Et l'approvisionnement des troupes devient difficile. En route, Jean, voyant Maurice pâlir, les yeux chavirés de lassitude, tâche de l'étourdir d'un flux de paroles, pour le tenir éveillé. Mais Maurice ferme les yeux et va tomber. Donne-moi ton flingot un instant, ça te reposera. On fait halte près d'Oches. Plusieurs soldats n'avaient pas la force de dresser leurs tentes. Ils s'endormaient où ils tombaient. Lorsque Jean voulut partager, manger l'un de ses biscuits (il lui en restait deux) et donner l'autre à Maurice, il s'aperçut que celui-ci dormait profondément ; il remit les biscuits au fond de son sac, avec des soins infinis, comme s'il eût caché de l'or : lui, se contenta de café. Des coups de feu les font se réveiller en pleine nuit.
Jean, désespéré de voir Maurice très pâle, lui demande s'il a toujours mal au pied. Maurice dit non, de la tête. Jean comprend que son ami est torturé par la faim, tire l'un des deux biscuits et dit, mentant avec simplicité : Tiens, je t'ai gardé ta part... j'ai mangé l'autre tout à l'heure. Suit une autre journée de marche, et les nouvelles qui arrivent sont alarmantes. Les voici arrivés à Raucourt, où ils espèrent manger. Mais le 1er Corps entier avait passé par là, balayant jusqu'aux miettes des maisons « bourgeoises. Au coin d'une rue, Maurice, pris d'un éblouissement, chancelle. Et comme Jean s'empresse :
— Non, dit-il, laisse-moi, c'est la fin... J'aime mieux crever ici.
Maurice est livide, les yeux fermés, à demi évanoui. Jean court à une fontaine voisine, emplit sa gamelle d'eau, revient et lui baigne le visage. Il tira le dernier biscuit, si précieusement gardé ; il se mit à le briser en petits morceaux, qu'il lui introduisait entre les dents. L'affamé ouvrit les yeux, dévora.
— Mais toi, demanda-t-il tout à coup, se souvenant, tu ne l'as donc pas mangé ?
— Oh ! moi, dit Jean, j'ai la peau plus dure, je puis attendre...
Et il avait lui aussi le visage d'une pâleur terreuse, si dévoré de faim, que ses mains en tremblaient.
— En route ! mon petit, faut rejoindre les camarades.
Maurice s'abandonna à son bras, se laissa emporter comme un enfant. Jamais bras de femme ne lui avait tenu aussi chaud au cœur... avec la mort en face, cela était pour lui un réconfort délicieux, de sentir un être l'aimer et le soigner. Il entendait battre son humanité dans la poitrine de Jean, et il était fier pour lui-même de le sentir plus fort, le secourant, se dévouant ; tandis que Jean, sans analyser la sensation, goûtait une joie à protéger chez son ami cette grâce, cette intelligence restées en lui rudimentaires. Depuis la mort de sa femme, il se croyait sans cœur, il avait juré de ne plus jamais en avoir de ces créatures dont on souffre tant, même quand elles ne sont pas mauvaises. Et l'amitié leur devenait à tous deux comme un élargissement : on avait beau ne pas s'embrasser, on se touchait à fond, on était l'un dans l'autre, si différent que l'on fût, sur cette terrible route de Remilly...
« Jamais bras de femme ne lui avait tenu aussi chaud au cœur. Dans l'écroulement de tout, au milieu de cette misère extrême, avec la mort en face, cela était pour lui d'un réconfort délicieux, de sentir un être l'aimer et le soigner ; et peut-être l'idée que ce cœur tout à lui était celui d'un simple, d'un paysan resté près de la terre, dont il avait eu d'abord la répugnance, ajoutait-elle maintenant à sa gratitude une douceur infinie. […] Et l'amitié leur devenait à tous deux comme un élargissement : on avait beau ne pas s'embrasser, on se touchait à fond, on était l'un dans l'autre, si différent que l'on fût, sur cette terrible route de Remilly, l'un soutenant l'autre, ne faisant plus qu'un être de pitié et de souffrance. » (Partie I, chapitre 6)
Ils arrivent à la Meuse. Là, Jean n'en peut plus, n'ayant rien mangé depuis près de trente-six heures. Maurice, après mille difficultés et dangers, finit par trouver du pain et du fromage à la maison d'un parent aux environs. Ils mangent à leur gré et s'assoupissent dans cette maison.
Ils entrent à Sedan. Dans la bousculade, ils se séparent. Jean, tombant de fatigue, erre dans les rues de Sedan à la recherche de la maison de la sœur de Maurice, où son ami avait promis de l'héberger, et où il est attendu. Il la trouve enfin. Il est fraternellement reçu par Henriette. On lui prépare un lit, il n'avait pas couché sur un lit depuis six semaines. Les deux amis font un somme réparateur de douze heures...
La vie de camp recommence. Et après tant de marches inutiles, ils sont en face des Prussiens. Jean conseille Maurice :
— Ecoute mon petit, tu ne vas pas me quitter, parce que, vois-tu, il faut savoir, si l'on ne veut pas attraper de mauvais coups. Moi, j'ai déjà vu ça, j'ouvrirai l'œil pour toi et pour moi.
Mais il arrive que pendant la bataille c'est Jean qui est blessé. Et cela au moment où l'ordre est donné de se replier. Une compagnie prussienne n'était plus qu'à deux ou trois cents mètres. On allait être pris. Maurice veut sauver son ami. Le lieutenant a un haussement d'épaules. Personne ne veut aider Maurice pour emporter le caporal blessé. Les Prussiens n'étaient plus qu'à cent mètres. Pleurant de rage, Maurice, resté seul avec Jean évanoui, l'empoigna dans ses bras, voulut l'emporter... réussit à s'éloigner d'une trentaine de pas ; et, un obus ayant éclaté près d'eux, il crut que c'était fini, qu'il allait mourir, lui aussi, sur le corps de son compagnon... Pourquoi donc ne fuyait-il pas ? Il était temps encore, il pouvait atteindre le petit mur en quelques sauts, et ce serait le salut. La peur renaissait, l'affolait. D'un bond, il prenait sa course, lorsque des liens plus forts que la mort le retinrent. Non, ce n'était pas possible, il ne pouvait pas abandonner Jean. Toute sa chair en aurait saigné. Il parvient finalement à traîner son ami à l'abri des coups. Jean rouvre les yeux. Jean semblait s'éveiller d'un songe... Ce Maurice si frêle, qu'il aimait, qu'il soignait comme un enfant, il avait donc trouvé, dans l'exaltation de son amitié, des bras assez forts pour l'apporter jusque-là !... Jean fut saisi d'un attendrissement d'homme simple, il empoigna Maurice, l'étouffa sur son cœur, en ne trouvant que ces mots :
— Ah ! mon cher petit, mon cher petit !
Suit une fuite à travers un bois. Les Prussiens criblaient de balles et d'obus. Des scènes effarantes. Ils parviennent à arriver à Sedan. Le mari d'Henriette est fusillé par les Prussiens à Bazeilles.
La capitulation. L'armée française prisonnière. Jean et Maurice marchent fraternellement côte à côte dans la captivité. Une chance leur permet de s'évader. Ils se dirigent vers la frontière de Belgique, en traversant un bois.
« Dans le bois, dans ce grand silence noir des arbres immobiles, quand ils n'entendirent plus rien, que plus rien ne remua et qu'ils se crurent sauvés, une émotion extraordinaire les jeta aux bras l'un de l'autre. Maurice pleurait à gros sanglots, tandis que des larmes lentes ruisselaient sur les joues de Jean... Et ils se serraient d'une étreinte éperdue... et le baiser qu'ils échangèrent alors parut le plus doux et le plus fort de leur vie, un baiser tel qu'ils ne recevraient jamais d'une femme, l'éternelle amitié, l'absolue certitude que leurs deux cœurs n'en faisaient plus qu'un, pour toujours. » (Partie I, chapitre 3)
C'est la deuxième fois que Zola fait la comparaison du lien qui unit les deux amis à la tendresse féminine, pour le trouver supérieur à celui-ci. Déjà, à Raucourt, « jamais bras de femme n'avait tenu aussi chaud au cœur de Maurice ». N'est-ce pas le cas de Jonathan qui aima David comme son âme ? Et la scène du bois ne rappelle-t-elle pas le passage de la Bible (I Samuel, 20, 41) : les deux amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble ?
Donc, les deux compagnons fidèles avaient réussi à s'évader. Mais ils perdent le chemin et ils se retrouvent près des Prussiens qui, ayant entendu du bruit dans la nuit, tirent et blessent Jean à la jambe, sans cependant le poursuivre. La balle est ressortie après avoir cassé le tibia. Dans la nuit, Maurice aide son ami et ils s'éloignent. Un cheval est trouvé, ils arrivent à atteindre, pour se cacher, la petite ferme d'un oncle de Maurice à Remilly. Et là commence la longue convalescence de Jean confié aux soins d'Henriette, la sœur de Maurice. Car Maurice s'en va, ne voulant pas accepter la défaite : il veut aller à Paris pour se battre contre l'envahisseur. Ils se séparent. Jean a les larmes aux yeux.
— Embrasse-moi, mon petit.
Et ils se baisèrent, et comme dans le bois, la veille, il y avait, au fond de ce baiser, la fraternité des dangers courus ensemble, ces quelques semaines d'héroïque vie commune qui les avaient unis, plus étroitement que des années d'ordinaire amitié n'auraient pu le faire. Les jours sans pain, les nuits sans sommeil, les fatigues excessives, la mort toujours présente, passaient dans leur attendrissement. Est-ce que jamais deux cœurs peuvent se reprendre, quand le don de soi-même les a de la sorte fondus l'un dans l'autre ? Mais le baiser, échangé sous les ténèbres des arbres, était plein de l'espoir nouveau que la fuite leur ouvrait ; tandis que ce baiser, à cette heure, restait frissonnant des angoisses de l'adieu. Se reverrait-on, un jour ? Et comment, dans quelles circonstances de douleur ou de joie ? (Partie III, chapitre 3)
Maurice en partant dit à sa sœur Henriette, très pâle sous ses noirs voiles de veuve :
— C'est mon frère que je te confie... Soigne-le bien. Aime-le comme je l'aime !
Il reste encore des mésaventures à passer pour les deux hommes jusqu'à la fin tragique.
Jean et Maurice se revoient à Paris. Mais la guerre fratricide les a séparés : Jean est avec les « Versaillais », Maurice contre « Thiers l'assassin ». Sur le boulevard Saint-Germain, ils se rencontrent et s'embrassent. Maurice tâche d'attirer à son camp Jean, pour sauver la République. Mais Jean répond :
— Ah ! non ! non ! mon petit, je ne reste pas si c'est pour cette besogne... Mon capitaine m'a dit d'aller à Vaugirard, avec mes hommes, et j'y vais. Quand le tonnerre de Dieu y serait, j'irai tout de même. C'est naturel. Tu dois sentir ça. Il s'était mis à rire, plein de simplicité.
Il ajouta :
— C'est toi qui vas venir avec nous.
Mais, d'un geste de furieuse révolte, Maurice lui avait lâché les mains. Et tous deux restèrent quelques secondes face à face, l'un dans l'exagération du coup de démence qui emportait Paris entier, ce mal venu de loin, des ferments mauvais du dernier règne, l'autre fort de son bon sens et de son ignorance, sain encore d'avoir poussé à part, dans la terre du travail et de l'épargne. Tous les deux étaient frères pourtant, un arrachement, lorsque, soudain, une bousculade qui se produisit les sépara.
— Au revoir Maurice !
— Au revoir Jean !
De la main, ils se saluaient encore, cédant à la fatalité violente de cette séparation, restant quand même le cœur plein l'un de l'autre.
Paris brûle... Sur une barricade, dans la nuit, Maurice est resté seul, allongé entre deux sacs de terre. Ses camarades avaient filé, épouvantés par l'idée d'être tournés d'un moment à l'autre.
Jean, à ce moment, débouche dans la rue du Bac, avec les quelques hommes de son escouade. Il aperçoit un communard qui remuait, qui épaulait, tirant encore dans la rue de Lille. Et ce fut sous la poussée furieuse du destin, il courut, il cloua l'homme sur la barricade, d'un coup de baïonnette...
Foudroyé, dégrisé, Jean le regardait... il s'abattit près de Maurice, sanglotant, le tâtant, tâchant de le soulever, pour voir s'il ne pouvait pas le sauver encore...
— Oh ! mon petit, mon pauvre petit ! (Partie III, chapitre 7)
Et il fait tout pour le sauver. Après avoir camouflé son ami d'une capote et d'un képi empruntés à un soldat mort, il le transporte, avec mille dangers et difficultés à travers Paris en flammes, puis dans une barque sur la Seine, au milieu de foyers immenses, jusqu'à la chambre qu'avait Maurice à Paris. Il trouve le moyen d'y amener un chirurgien. Peines perdues. Maurice, après quelques jours, meurt malgré les soins de sa sœur Henriette et de Jean.
Symboles de deux archétypes de l'époque, Jean Macquart (saine France, travail, épargne, bon sens, reconstruction) et Maurice Levasseur (Empire pourri, lettré progressiste, mais prêchant la guerre), Zola les a enlacés dans un amour profond qui les garde unis au-delà des entraves de leur culture différente (ou bien grâce à cette différence de niveau intellectuel) et de la politique.
Si la relation entre les deux hommes ne résume pas ce roman militaire, elle en constitue une colonne vertébrale. En effet les amours de Weiss-Henriette, Silvine-Goliath, Silvine-Honoré, les amours légères de Gilberte, une ébauche de lien latent entre Jean et Henriette prennent par proportion un caractère tout épisodique. La magistrale fresque du mouvement des armées, des batailles, de l'extermination, des jours de la Commune, ne sont qu'un majestueux décor à l'idylle.
Du même auteur : La faute de l'Abbé Mouret – La Curée
Lire aussi la chronique de Lionel Labosse de « La débâcle » sur son site altersexualite.com

/image%2F1477403%2F20150214%2Fob_a07756_banniere-blog-nouvelle-version-2015.jpg)


/idata%2F0051799%2Flogo%2Flivre2.jpg)