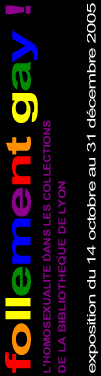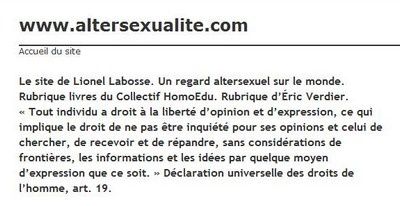L'amour proustien par Guy Laurent
 Dès qu'il est proclamé « classique » un écrivain y gagne au moins de n'être plus suspect et d'être lu avec toutes les bienveillantes œillères du conformisme. Singulièrement anesthésié par cette étiquette, le « bourgeois hétérosexuel » lira sans sourciller Sade, Lautréamont ou Proust. Quelques rares lueurs seront seules à signaler à notre inconscient navigateur les précipices frôlés ; c'est alors que sa gêne se rabattra sur le bel alibi de la valeur stylistique ou mieux encore sa conscience étonnée se félicitera une fois de plus d'ignorer semblables errements. Il y a pourtant des auteurs classiques et gênants et Racine, leur « tendre » Racine, est l'un d'eux et chez ces auteurs, des zones plus gênantes encore sur lesquelles la critique écartelée, comme l'âne de Buridan s'emploie à parler par sous-entendu pour mieux se taire. Le dieu de Schopenhauer se voilait bien la face devant le spectacle du monde. C'est ainsi qu'on n'a jamais trop cherché à analyser les profondes racines homosexuelles de l'amour proustien. Cet article qui ne vise ni à être exhaustif ni surtout nuancé se propose seulement de parler un peu des côtés de Proust que beaucoup voudraient voiler. Qu'on n'y voie donc autre chose que les remarques d'un homophile qui a beaucoup aimé Proust. Comme tous les bons esprits le savent, nous sommes affligés d'une singulière manie qui nous pousse à rechercher chez tous les écrivains, chez tous les créateurs, des résonances à nos problèmes, des échos à nos désirs. Il s'agit ici de Proust et comme les résonances risquent de se transformer en une complète symphonie, nous irons au plus bref tout en priant nos lecteurs arcadiens de n'y voir que le premier d'une série d'articles consacrés au plus grand des écrivains homosexuels et peut-être au plus significatif. Puissent les mânes du pauvre Marcel promu encore par certains au titre d'hétérosexuel posthume – et sans s'être jamais douté de l'être – y trouver quelque apaisement !
Dès qu'il est proclamé « classique » un écrivain y gagne au moins de n'être plus suspect et d'être lu avec toutes les bienveillantes œillères du conformisme. Singulièrement anesthésié par cette étiquette, le « bourgeois hétérosexuel » lira sans sourciller Sade, Lautréamont ou Proust. Quelques rares lueurs seront seules à signaler à notre inconscient navigateur les précipices frôlés ; c'est alors que sa gêne se rabattra sur le bel alibi de la valeur stylistique ou mieux encore sa conscience étonnée se félicitera une fois de plus d'ignorer semblables errements. Il y a pourtant des auteurs classiques et gênants et Racine, leur « tendre » Racine, est l'un d'eux et chez ces auteurs, des zones plus gênantes encore sur lesquelles la critique écartelée, comme l'âne de Buridan s'emploie à parler par sous-entendu pour mieux se taire. Le dieu de Schopenhauer se voilait bien la face devant le spectacle du monde. C'est ainsi qu'on n'a jamais trop cherché à analyser les profondes racines homosexuelles de l'amour proustien. Cet article qui ne vise ni à être exhaustif ni surtout nuancé se propose seulement de parler un peu des côtés de Proust que beaucoup voudraient voiler. Qu'on n'y voie donc autre chose que les remarques d'un homophile qui a beaucoup aimé Proust. Comme tous les bons esprits le savent, nous sommes affligés d'une singulière manie qui nous pousse à rechercher chez tous les écrivains, chez tous les créateurs, des résonances à nos problèmes, des échos à nos désirs. Il s'agit ici de Proust et comme les résonances risquent de se transformer en une complète symphonie, nous irons au plus bref tout en priant nos lecteurs arcadiens de n'y voir que le premier d'une série d'articles consacrés au plus grand des écrivains homosexuels et peut-être au plus significatif. Puissent les mânes du pauvre Marcel promu encore par certains au titre d'hétérosexuel posthume – et sans s'être jamais douté de l'être – y trouver quelque apaisement !
Il n'y a pas d'œuvre nantie d'une architecture plus secrète que celle qui rassemble les divers moments d' « A la Recherche du Temps perdu ». Ce n'est pas seulement coquetterie, volonté de brouiller les pistes mais surtout le dessein de suggérer au lecteur l'effort nécessaire, ce droit de péage intellectuel qui permet d'accéder à la ville interdite, au jardin intérieur. Car le premier tome « Du côté de chez Swann » n'est que la délicate exploration de ce jardin, image même de la conscience proustienne, telle qu'elle se révèle à nous d'abord et aussi de ce milieu clos, tracé au cordeau, mesuré, de l'enfance où tout se développe selon l'heureuse germination des saisons, l'afflux des sensations. Toute violence, toute idée de rupture est bannie de ce « vert paradis des amours enfantines ». Amours enfantines qui ne s'adressent pas aux êtres de l'extérieur, à ces indifférents étrangers mais aux différentes cellules de ce clan, personnes et choses, parents, chambre et domestiques. Au commencement donc l'enfant Marcel Proust se promenait ravi et satisfait dans les allées de ce jardin à la française : le plaisir était sans problème car planait par-dessus ce décor l'ombre auguste et propice de la mère. La mère, c'est-à-dire un tout facile et complaisant, toujours prêt à donner plus encore et ne refusant plus ses baisers lorsque coulaient les larmes. Nous retrouvons ici la situation caractéristique, et peut-être la loi d'airain qui guide le développement affectif du jeune homosexuel. Est-il besoin d'ajouter que certains biographes ont voulu y voir la preuve d'un attachement « anormal » sans qu'à la vérité, ils se soient bien expliqué là-dessus. Rien n'est plus étonnant à qui lit des critiques que ce genre d'insinuations et surtout que ce sentiment de malaise hésitant avec lequel on avance des sous-entendus. Il y a dans le monde des millions d'homophiles qui continuent d'éprouver pour leur mère des sentiments du même ordre. Mieux, ils leur semblent si évidents et si familiers que, chez Proust, rien de ce qu'il dit, touchant ses rapports avec sa mère, ne les étonne : cette attitude leur paraît simplement significative mais, dans ce domaine, comme dans celui qui en découle directement, l'incompréhension des hétérosexuels ne découle que d'une ignorance fondamentale. A preuve ces stupides insinuations d'inceste. Mais laissons-là les critiques ! Nous avons laissé notre Proust nourrisson à Combray ou à Paris, gavé du lait de la tendresse maternelle, égoïstement habitué à ce bonheur sans lutte, parèdre et protégé de sa déesse, en un mot englouti dans un rêve nervalien de bonheur. Il est en effet curieux de constater combien Gérard de Nerval est l'un de ceux auxquels Proust s'est le plus attaché durant son adolescence, un de ceux qui l'obsèdent. C'est un peu sa première manière, son maître à penser et à rêver. La raison de cet attachement est bien simple et, évidemment, de nature toute homophile. L'univers nervalien, baigné d'une clarté lunaire et maternelle, est celui des métamorphoses, du chatoyant, du changeant : c'est, en quelque sorte, un prolongement esthétique de cet univers enfantin sur lequel la vigilante tendresse d'une mère verse ses rayons pâles, mais encore suffisants. Toute la passive sensualité œdipienne de Marcel Proust se réjouit de ce plongeon dans la magie impubère, créatrice éternellement féconde de formes et de sensations. Cette lactescence imprègne « Du côté de chez Swann » jusqu'à faire de ce livre le seul moment vraiment heureux de l'œuvre toute entière. De là, l'esthétisme gourmand de Proust, ses savoureuses descriptions, cet univers confortable, ces êtres proches et sans mystère : tante Léonie, Françoise. L'humour de l'auteur présentant les petits travers de sa tante Léonie, ses maladies plus ou moins imaginaires ou les bizarreries de sa bonne, reste souriant, allégé, heureux sans rien de commun avec l'ironie méchante du snob ou les remarques caustiques de l'amant des livres suivants. Le sommeil et plus spécialement le sommeil heureux auprès de sa mère est le thème de prédilection de notre auteur dans ce livre ; thème symbolique et utilisé à dessein. C'est qu'avec lui nous nous sommes assis sur les pelouses de notre enfance et, Viviane enchantant Merlin, nous oublions que le temps passe et que l'heure de l'action, l'heure de l'amour nous trouvera enchaînés dans cette délicieuse torpeur dont nous ne connaissons le prix qu'au réveil et qui, pour Marcel, s'appelait le bonheur. Hier, une baguette complaisante pulvérisait la réalité du monde en gerbes irisées de métaphores : un nom devenait bouquet de violettes, un buisson d'aubépines un reposoir et le clocher un ami ; mais, aujourd'hui, à Balbec, d'agréables formes ont arrêté nos regards, nous avons rencontré « la petite bande... ». De prime abord, l'objet aimé n'est qu'une promesse de bonheur fort vague : sur l'oreiller des illusions, il est encore aisé de rêver soit que nous ayons discerné un jeune aristocrate séduisant qui s'appelle Robert de Saint-Loup ou un garçon laitier aux joues roses. Proust est un enfant gâté : le désir précède toujours l'amour : pas de coup de foudre ni d'explosion solaire du sentiment. Sur le paravent d'un univers plein de délices, un ou plusieurs êtres apparaissent successivement et nous pensons qu'il nous sera facile de tirer de chacun des pores de ces objets si désirables l'exacte quantité de plaisir que notre convoitise réclame. Ne sommes-nous pas doués de cette imagination ravisseuse et élastique qui nous permet de tout pénétrer et de tout inclure, en un mot ne sommes-nous pas certains de tout savoir afin de tout posséder. Ce besoin de savoir, dépassant de fort loin la simple curiosité, est l'instrument même de l'enfant-romancier. Proust qui joue au policier s'amuse à tout comprendre pour mieux nous livrer orgueilleusement les secrets que sa sagacité a pu forcer. Dans cette chasse triomphante, s'affirme « ce prolongement et cette multiplication possible de soi-même qui est le bonheur ». C'est pourquoi devant la « petite bande » Proust admire sans crainte « les nobles et calmes modèles de beauté humaine » qu'il voyait là « devant la mer, comme des statues exposées au soleil, sur un rivage de la Grèce » et parmi ses compagnes Albertine n'est qu'une brune aux grosses joues assez mal élevée pour sauter brutalement par-dessus un paisible octogénaire, assis sur le sable. (Il est inutile d'insister, puisque c'est le projet d'un autre article, sur les innombrables allusions qui font comprendre qu'il s'agit de garçons et non de jeunes filles. Je les crois pour ma part tout à fait voulues et destinées aux « happy few »). A peine Albertine a-t-elle été entrevue que le mauvais génie semble déjà opérer : c'est la distance qui le sépare de cette jeune fille qui provoque le désir, qui est l'élément moteur. « Cette fugacité des êtres qui ne sont pas connus de nous, qui nous forcent à démarrer de la vie habituelle, où les femmes que nous fréquentons finissent par dévoiler leurs tares, nous met dans cet état de poursuite où rien n'arrête plus l'imagination. » Mais la « fugacité » d'Albertine n'est encore qu'une hypothèse : pour que ce « précipité » de souffrances qui s'appelle l'amour voit ses éléments d'angoisse et de désir réunis, il faut le catalyseur d'un fait précis, d'un élément réel et non rêvé. Au moment où il va quitter Albertine à tout jamais, bien décidé à aimer Andrée, autre visage de la petite bande, au moment où le train arrive à Pareille où Albertine doit descendre, Marcel apprend incidemment l'existence de « deux grandes sœurs » de sa maîtresse : Mlle Vinteuil et son amie, deux lesbiennes qu'il a pu voir, un soir, à Montjouvain, pratiquant le saphisme. L'amour est né : « Je sentis que le jour qui allait se lever dans un instant et tous les jours qui viendraient ensuite ne m'apporteraient plus jamais l'espérance d'un bonheur inconnu, mais le prolongement de mon martyre. » L'amour proustien est un soupçon jaloux éternellement frustré d'une conviction apaisante. C'est que le rapport d'autrui à soi est complètement inversé chez Proust : pour le sens commun, les êtres impénétrables ne sont que les indifférents, ceux que nous n'aimons pas ; au contraire, c'est dans le contact avec l'objet aimé que nous puisons connaissance aussi bien que bonheur. La malédiction de la chasse au bonheur proustienne vient de ce que la conception des rapports est entièrement opposée. Jamais la connaissance de Legrandin ou de Françoise n'est mise en cause ; elle procède de soi ; Proust est au centre de son œuvre comme Dieu dans la sienne. Mais lorsqu'apparaît l'amour, les charmes habituels se révèlent inefficaces et l'enchanteur prodigue de métaphores brillantes qui affirmaient l'impérialisme de notre sensualité, se révèle un mauvais génie qui ne montre que pour mieux voiler. Chaque fragment, chaque « instantané » d'Albertine, n'est plus en effet pour rehausser le charme ou l'éclat métaphorique de la vision pour enivrer le jeune esthète mais pour dissimuler farouchement le secret inconnu d'une âme. Tantôt paysage, tantôt minéral, où est la véritable Albertine? « Quel homme se cachait derrière Albertine ? », s'est écrié Mauriac ; c'était hélas la douloureuse question qui obsédait Proust. Ici commence l'enfer proustien qui est aussi celui de bien des homophiles. A partir du moment où les rapports sont ceux que concevait Proust et auxquels, probablement, il lui était impossible d'échapper, relations de protecteur riche avec un garçon complaisant et passablement désœuvré, rien ne saurait garantir la réciprocité de son attachement, pas plus que les préférences sexuelles du partenaire. Les penchants saphiques d'Albertine sont une transposition tellement évidente qu'il est inutile d'y insister : Albert est soupçonné d'aimer les femmes. Mais on en reste aux présomptions. L'esprit de l'auteur se perd dans un dédale de combinaisons, ruses, traquenards qui lui permettraient d'atteindre une vérité tangible, énorme, salvatrice...
Ainsi l'aérolithe de l'amour a fracassé le fragile petit univers nervalien : l'âme du narrateur s'imprègne d'une souffrance sans nom et sans remède, « tremblante et dépaysée comme une méduse échouée sur la grève ». Le temps proustien n'est pas plus uniforme que celui de la vie ; son récit est à épisodes tranchés comme son âme est constituée des facettes les plus diverses. Cette simple phrase d'Albertine : « Je connais très bien Mlle Vinteuil », fait passer Proust de l'adolescence à la maturité, de l'âge du jeu à l'âge du risque : l'amour est une renaissance douloureuse. C'est pourquoi le ton de « La Prisonnière » et de « La Fugitive » diffère entièrement de celui de « Du côté de chez Swann » ou du « Temps retrouvé » : la souffrance tord le style qui n'exprime plus que le besoin immense d'un monomane obsédé. La raison en est à la fois bien simple et bien spécieuse, c'est que l'amour n'éclate que lorsque le sentiment de la perte se fait jour. Albertine, petit animal sexuel et divertissant, ne séduit vraiment le narrateur que lorsque le hasard de la Révélation l'a fait « autre ». Chez un écrivain que l'on a dit mou ou par trop féminin, l'amour, dès la première passe, est un duel. Proust, en effet, veut se battre contre une « nature » différente – ce qui est à la fois absurde et grandiose. Ici et, sans doute, plus nettement que jamais, le réflexe homosexuel est évident. Le côté incurablement enfantin de l'homophile s'exaspère en voyant qu'un objet ou un être séduisant entrevu lui échappent. De plus, sans cesse en compétition avec un milieu qui le nie, l'homosexuel éprouve ardemment le besoin de soumettre l'élément viril de cette société sous la forme du beau garçon qui consacrera sa victoire, je veux dire son bonheur. Malgré cela, l'on s'est souvent plu à comparer les mécanismes de l'amour chez Proust à ceux d'autres grands écrivains. A la suite de quoi, des libéraux ont conclu – non sans un candide étonnement – que la différence d'objet n'était pas pour autant une différence de nature et que l'amour chez l'homosexuel Proust ressemblait à s'y méprendre à l'amour chez l'hétérosexuel Racine : même fureur dans le sentiment, même accroissement monstrueux de la jalousie, même soif en un mot. C'est à notre avis une erreur totale. Malgré des éléments certains de comparaison, la nature de l'amour est tout à fait différente. Avant que de connaître l'existence, voire la possibilité d'une rivale, Phèdre brûle pour Hippolyte et Hermione pour Pyrrhus. Dans le cours de leur passion la jalousie irrite leur amour, elle ne le crée pas. On voit mal Hermione se lassant de Pyrrhus ; en revanche il suffit qu'Albertine vive chez le narrateur pour que, la jalousie s'apaisant, l'amour se tarisse : « D'Albertine je n'avais plus rien à apprendre — Chaque jour elle me semblait moins jolie — Seul le désir qu'elle excitait chez les autres quand, l'apprenant, je recommençais à souffrir et voulais la leur disputer, la hissait à mes yeux sur un haut pavois — Elle était capable de me donner de la souffrance, nullement de la joie — Par la souffrance seule, subsistait mon ennuyeux attachement — Dès qu'elle disparaissait, et avec elle le besoin de l'apaiser, requérant toute mon attention comme une distraction atroce, je sentais le néant qu'elle était pour moi, que je devais être pour elle. » Si l'amour n'est plus chez Proust qu'une maladie nerveuse qui ne cherche même pas à propager ses ondes sur l'être aimé (aucun de ses personnages ne dit jamais « je vous aime »), si, malgré l'importance démesurée qu'il revêt pour celui qui en est la proie, il n'est qu'une crise violente et passagère, c'est parce qu'il est condamné dès le départ. Proust ne peut pas communiquer avec Albertine et cela non parce qu'il est un « intellectuel compliqué », non parce qu'il aime souffrir mais parce qu'Albertine est Albert, parce que Proust, pour son malheur, n'aime que les hommes de l'autre race. Cependant l'obstacle n'est pas simplement physiologique : Albertine-Albert a des relations sexuelles avec Proust, mais métaphysique et la jalousie, elle-même, est de nature métaphysique : l'homosexuel ne peut comprendre la dimension hétérosexuelle de son ami. La crise de l'amour proustien est celle de la finitude homosexuelle...
Ainsi, selon la belle formule qui introduit « La Fosse de Babel », « La Prisonnière » est le « monument élevé à l'impossibilité de l'amour par le paroxysme de l'amour ». A qui ne peut posséder une essence différente de la sienne, il restera le plaisir d'évoquer la beauté des formes, « l'énervement sodomique » comme le dira Abellio. Il doit se faire magicien, celui qui est dépouillé d'une part du réel. Ainsi Proust, à nos yeux, est un esthète et non un amoureux : il n'avait pas le choix.
Arcadie n°119, Guy Laurent (Guy Pomiers), novembre 1963

/image%2F1477403%2F20150214%2Fob_a07756_banniere-blog-nouvelle-version-2015.jpg)


/idata%2F0051799%2Flogo%2FARCADIE-LOGO.jpg)
/image%2F1477403%2F20180209%2Fob_4b3279_andre-baudry-deces-2018.jpg)